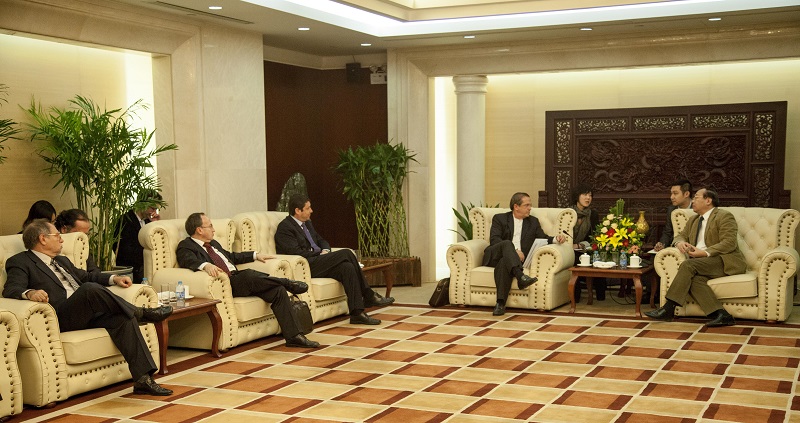Déc 3, 2016 | Diplomatie, Environnement, Passage au crible, Réchauffement climatique
Par Simon Uzenat
Passage au crible n° 151
> Versión en español
 Source: Chaos International
Source: Chaos International
La 22e CdP (Conférence des Parties) à la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques) s’est réunie à Marrakech du 7 au 19 novembre 2016. Elle a rassemblé plus de 22000 participants – en retrait de 40% par rapport à la Conférence de Paris –, dont près de 16000 responsables gouvernementaux, plus de 5000 représentants des organisations onusiennes, des OIG (Organisations Intergouvernementales) et ONG (-50%) et 1200 des médias (-66%). Il s’agissait d’une conférence essentiellement technique chargée de détailler la mise en œuvre de l’élan diplomatique entériné par la 21e CdP et formalisé dans l’Accord de Paris. Ce dernier est entré en vigueur le 4 novembre 2016, trente jours après sa ratification par 55 pays représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La 22e CdP a donc logiquement coïncidé avec la réunion de la première partie de la première session de la CMA (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement).
Cette conférence internationale a par ailleurs été largement marquée par l’élection à la présidence des États-Unis, le 8 novembre 2016, du candidat républicain climato-sceptique Donald Trump. Ce dernier avait clairement annoncé son intention de ne plus engager son pays dans la voie dessinée à Paris un an plus tôt. Cet événement politique a participé à renforcer le climat d’incertitude qui entoure la réalisation, dans un délai raisonnable, des objectifs concrets (atténuation, financements, transferts de technologie) indispensables à la résilience climatique.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Depuis leur origine, les négociations climatiques sont scandées par une alternance de temps forts diplomatiques (Kyoto, Copenhague, Paris) connaissent des résultats inégaux et de conférences de nature plus opérationnelle en vue de préparer la finalisation d’un accord majeur ou d’en détailler la mise en œuvre. À cet égard, la 22e CdP s’inscrit dans une séquence multilatérale relativement proche de celle qui prévalait déjà quinze ans plus tôt, lorsque le Maroc accueillit pour la première fois les négociateurs du climat. Du 29 octobre au 9 novembre 2001, les délégués de la 7e CdP se réunirent en effet à Marrakech pour préciser les modalités d’application du protocole de Kyoto signé en 1997, en arrêtant la traduction juridique du plan d’action de Buenos Aires, adopté en 1998, dans le cadre des Accords de Marrakech. L’élection du président Georges W. Bush, fondamentalement opposé à toute démarche contraignante qui épargnerait la Chine et les pays en développement, suscita de fortes inquiétudes. En particulier lorsqu’il officialisa son choix, en mars 2001, de ne pas transmettre au sénat américain le protocole pour ratification. Conjugué à d’autres tensions liées à l’ampleur et au calendrier de réduction des émissions pour les pays développés visés à l’Annexe I du protocole, cet unilatéralisme de la puissance américaine contribua à retarder l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto qui n’intervint finalement que le 16 février 2005.
Préalablement à la 22e CdP, plusieurs décisions de portée internationale ont cependant entretenu la dynamique de l’Accord de Paris. Tout d’abord, la résolution votée le 6 octobre 2016 par l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) qui instaure un mécanisme mondial de compensation des émissions de l’aviation internationale. Ensuite, l’amendement de Kigali, adopté le 15 octobre 2016 après sept années de négociations dans le cadre du protocole de Montréal, et qui entérine l’élimination progressive des hydrofluorocarbures (HFC) à l’effet de serre 14000 fois plus puissant que le CO2.
Cadrage théorique
Le déroulement de la 22e CdP et ses résultats contrastés s’inscrivent dans un double mouvement qui enregistre autant qu’il accompagne les reconfigurations en cours de la scène mondiale.
1. Un multilatéralisme fragmenté. L’arène climatique fait l’objet d’une décomposition stratégique des espaces-temps de la négociation internationale (conférences, groupes de travail, partenariats, plans, programmes, fonds). Leur multiplication répond certes à la complexité grandissante des enjeux (scientifiques, technologiques, financiers) et à la diversification des échelles d’intervention (du local au global). Mais elle permet surtout de circonscrire les tensions potentielles en réduisant au maximum le dénominateur commun d’acteurs profondément hétérogènes et concurrentiels. Avec la fin de l’approche contraignante actée à Copenhague, cette atomisation porte en elle le risque de réduire la portée opérationnelle des promesses climatiques.
2. Une redéfinition du calendrier climatique. Obéissant à une logique incitative, fondée sur le consentement et la bonne volonté, l’Accord de Paris a arrêté un objectif de (très) long terme en renonçant à tout calendrier impératif, alors même que l’urgence est unanimement reconnue. En ajoutant de nombreuses échéances intermédiaires (2018, 2020, 2050) dépourvues d’objectifs, non assorties de sanctions et variant en fonction des sujets (atténuation, financement de l’adaptation), la négociation climatique diminue considérablement la probabilité de limiter le réchauffement à 2°C d’ici 2100. Jusqu’à présent, les contributions volontaires des États conduiraient plutôt à une hausse supérieure à 3°C.
Analyse
À l’initiative de sa présidence marocaine et après des modifications demandées par différents groupes de pays, la Conférence de Marrakech a adopté la Proclamation d’action pour notre climat et le développement durable (Marrakech Action Proclamation ou MAP). Il s’agit en réalité d’une déclaration d’intention qui se contente de rappeler les promesses de Paris : le « devoir impérieux de répondre à l’urgence climatique », la nature inclusive de l’Accord dans le respect des responsabilités partagées et différenciées des États. En exprimant une volonté qui s’apparente à une prophétie autoréalisatrice, un « changement urgent, irréversible et imparable » pour reprendre les termes de la nouvelle secrétaire exécutive de la CCNUCC, Patricia Espinosa, cette proclamation prend acte des nombreux obstacles sur le chemin de la résilience climatique : « Nous appelons à une forte solidarité avec les pays les plus vulnérables, […] nous appelons tous les acteurs non-étatiques à se joindre à nous pour une mobilisation et une action immédiates et ambitieuses ». Même si la date anticipe d’une année le choix arrêté à Paris, les gouvernements ont toutefois fixé l’échéance de 2018 – une année trop tard pour les PMA (Pays les Moins Avancés) – pour finaliser la réalisation opérationnelle de l’Accord de Paris, année de la réunion de la 24e CdP et de la troisième partie de la première session de la CMA.
Les ambiguïtés de l’Accord de Paris ont, quant à elles, clairement affecté le rythme et la qualité du travail des négociateurs, de surcroît en l’absence de vision globale sur les engagements des États et leur contrôle. Les difficultés inhérentes à la mise en place des instances de discussion dans le cadre de cet accord ont également participé d’une forme de procrastination : malgré l’incompréhension de nombreux délégués, l’APA (Ad Hoc Working Group on Paris Agreement) ne s’est pas réuni la deuxième semaine de la conférence, alors que les différences d’approches et de calendrier en vue des prochaines sessions auraient pourtant réclamé des échanges complémentaires. L’élection de Trump s’est également invitée dans les salles de réunions et dans les propos des leaders politiques. Si le futur président américain dispose des moyens juridiques pour soustraire son pays de l’Accord de Paris avant la fin de son mandat, l’entrée en vigueur rapide de ce traité, l’élan international qu’il a suscité, la forte implication chinoise – premier émetteur mondial de gaz à effet de serre – et les appels d’acteurs non-étatiques américains, tels de grandes firmes comme Nike et Starbucks ou des autorités locales, rendent désormais un désengagement total peu probable. Rendu possible par la grande souplesse formelle du texte, le principal danger américain demeure celui de l’inertie et des manœuvres dilatoires.
Plusieurs initiatives parallèles ont tenté de contrebalancer cet état de fait en dynamisant l’arène climatique. La feuille de route de Marrakech du sommet des élus locaux et régionaux pour le climat, qui s’est tenu le 14 novembre, appelle ainsi à la « création de modalités renforcées et simplifiées d’accès direct aux fonds climat internationaux dédiés » et annonce le lancement en 2017 d’une campagne mondiale pour la localisation de la finance climat. Il s’agit d’une réponse au constat que « les moyens continuent de manquer pour répondre à l’ambition affichée par la communauté internationale ». De nombreux élus ont à cet égard été marqués par les propos des championnes française et marocaine du climat, Mmes Laurence Tubiana et Hakima El Haité, lors de la cérémonie de clôture du sommet, leur demandant de réfléchir à la vision de leur territoire en 2050, sans jamais évoquer les moyens disponibles pour les collectivités à court et moyen termes.
Le 15 novembre, 42 pays ont signé le partenariat NDC (Nationally Determined Contribution), co-présidé par le Maroc et l’Allemagne. Il a pour ambition d’être une plateforme de collaboration entre pays en développement, pays développés et institutions internationales afin d’accompagner et d’accélérer la mise en oeuvre des NDC dans tous les secteurs et à tous les niveaux de prise de décision des pays en développement. Il propose notamment une base de données en ligne – réalisée avec la CCNUCC, le gouvernement du Maroc et l’agence de coopération internationale allemande – qui recense plus de 300 fonds bilatéraux et multilatéraux.
Le lancement du Marrakech Partnership for Global Climate Action par les championnes du climat, en présence du président de la 22e CdP, M. Salaheddine Mezouar, et du Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, a pour ambition d’encourager l’action des acteurs non-étatiques pour la période 2017-2020. Dans la continuité du plan d’action Lima-Paris transformé en Global Climate Action Agenda, ce partenariat est avant tout destiné à conforter et valoriser les engagements concrets au-delà des promesses plus ou moins tenues par les États. Il s’agit en l’espèce d’accentuer les efforts avant 2020 pour pouvoir se maintenir en-deçà du seuil des 2 degrés. La question financière demeure également centrale : les investissements dans les infrastructures en vue de les rendre compatibles avec une économie bas carbone représenteront 4000 milliards de dollars pour les 15 prochaines années. Ainsi, l’on voit bien que les 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 qui devraient être financés par les pays développés et qui sont débattus depuis Copenhague ne représentent qu’une goutte d’eau dans l’océan de l’urgence climatique. La détermination à agir s’avère par ailleurs si faible que l’identité du pays candidat à l’accueil de la 23e CdP n’a été connue qu’au cours de la conférence de Marrakech. Il a été décidé que la présidence serait en l’occurrence assurée par le gouvernement des îles Fidji et la conférence se déroulera au siège de la CCNUCC à Bonn.
Malgré les nombreuses alertes scientifiques, les cris d’alarme des populations les plus vulnérables et les multiples mobilisations transnationales, les engagements actuels des États demeurent encore loin de garantir la justice climatique. La reconfiguration partielle de l’arène climatique, impliquant davantage les acteurs non-étatiques, pourrait amender cette inertie à la condition de déployer de substantiels moyens humains et financiers.
Références
Aykut Stefan C., Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2014.
Barrett Scott, Environment and Statecraft: the Strategy of Environmental Treaty-Making, Oxford, Oxford University Press, 2003.
Keohane Robert O., Victor David G., « The Regime Complex for Climate Change », Perspectives on Politics, 9 (1), 2011, p. 7-23.
Uzenat Simon, « Une reconfiguration partielle de l’arène climatique. Le 1er Sommet Climate Chance des acteurs non-étatiques, 26-28 septembre 2016 à Nantes », Passage au crible (147), 2 nov. 2016 : cliquez ici : http://urlz.fr/4thT
Déc 3, 2016 | Arabe, Équipe éditoriale, Organisation, Pôles traductions, Qui sommes-nous ?
Nov 28, 2016 | Chine, Développement, Mondialisation, Passage au crible, Politique étrangère
Par Moustafa Benberrah
Passage au crible n° 150
> Versión en español
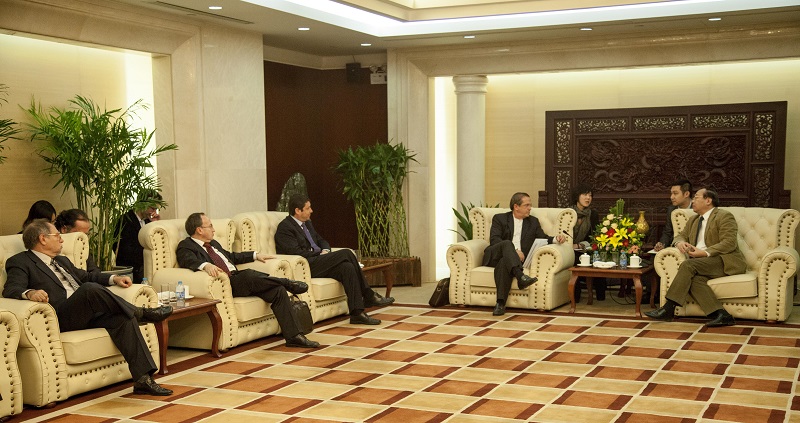 Source: Wikimedia
Source: Wikimedia
Après quatre ans de travaux, l’Ethiopie a inauguré au début du mois d’octobre une ligne ferroviaire entre sa capitale Addis-Abeba et Djibouti. Construite par la Chine, cette nouvelle liaison doit permettre de désenclaver l’économie éthiopienne en lui ouvrant, notamment, une porte sur la mer Rouge. Rappelons à cet égard que ce chantier de 3,4 milliards de dollars (3 milliards d’euros) a été financé à 70 % par la banque d’investissement chinoise Exim.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
L’implantation grandissante de la Chine à l’étranger donne à voir le signe incontestable d’une transformation de son statut mondial. Répondant en effet à l’appel à « sortir du pays » (zouchuqu) lancé par l’ancien président Hu Jintao en 2005, le pays s’internationalise en quête de nouveaux marchés et de sources d’approvisionnement. Par ailleurs, il recherche aussi dans le même temps des alliés. Cette offensive se développe dans des zones traditionnellement marquées par la présence occidentale. Dans ce cadre, Pékin ne cesse d’étendre son influence sur le continent africain en organisant par exemple des sommets Chine-Afrique fondés sur le multilatéralisme. Ce faisant, cette stratégie contribue à rehausser et à consolider sa stature désormais mondiale.
Les échanges entre la RPC (République Populaire de Chine) et l’Afrique s’élevaient à 200 milliards de dollars en 2015, contre 12.39 milliards de dollars en 2002. En mai 2014, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a déclaré vouloir doubler ce résultat d’ici 2020. Aujourd’hui, il est clair que la République populaire a réussi à s’imposer comme le premier partenaire commercial de nombreux États africains. Plus de 2500 sociétés chinoises implantées en Afrique couvrent une variété de secteurs, dont les hydrocarbures et le BTP (bâtiment et travaux publics). Ce dernier domaine offre, il est vrai, une vitrine qui témoigne du savoir-faire de ses compagnies et du professionnalisme de ses travailleurs. De surcroît, investir ainsi correspond au discours officiel qui souligne régulièrement la nécessité de soutenir un continent considéré avant tout comme un partenaire à part entière et non comme un simple marché.
La présence financière de cette nation repose essentiellement sur des prestations de services et des IDE (investissements directs à l’étranger), deux vecteurs qui lui ont permis de devenir l’un des principaux investisseurs à l’étranger. Néanmoins, cette situation doit être appréciée dans ses justes proportions. L’investissement chinois en Afrique ne représente que 0,2% de ses IDE sur le plan mondial. Le BTP illustre bien cette réalité car dans ce secteur, les compagnies chinoises ne deviennent ni propriétaires, ni détentrices de droits sur les infrastructures. Or, la définition des IDE adoptée par les organisations internationales suppose de détenir « la propriété de 10% ou plus des actions ou des droits de vote d’une entreprise » pour devenir un « investisseur ». Par conséquent, l’implantation chinoise sur le continent africain emprunte de nouvelles formes, plus indirectes, très caractéristiques, au demeurant du processus de mondialisation en cours.
Cadrage théorique
1. Une emprise pragmatique. Pour Johnson Chalmers, ce type d’orientation renvoie à un État fort qui, tout en pilotant les politiques industrielles et en orientant la production, encourage une large autonomie managériale. En d’autres termes, cette configuration privilégie davantage l’augmentation des parts de marché que le profit à court terme.
2. La montée en puissance d’un État développeur. L’État chinois s’affirme à présent comme un acteur central de la coopération internationale. Il exerce ses prérogatives de puissance publique soit directement, soit par le biais d’intermédiaires qu’il sélectionne. Cependant, certains acteurs échappent alors à son contrôle et contestent parfois son autorité.
Analyse
Pendant longtemps la République populaire de Chine a refusé d’évoquer « l’aide ». Elle préférait jusque-là faire référence à une « coopération gagnant-gagnant » ou à une « assistance mutuelle » entre pays du Sud. Il a fallu attendre son livre blanc sur l’aide au développement publié en avril 2011 pour que le gouvernement adopte finalement ce terme. Ce document impose aux pays récipiendaires l’aide liée qui implique nécessairement une procédure d’achat en retour (buy-back) accompagnée de contrats globaux. Par voie de conséquence, ces dispositions déterminent le recours obligatoire à des firmes et à leurs travailleurs ainsi qu’un paiement en matières premières. Ce « modèle angolais » s’applique plutôt aux pays d’Afrique centrale qu’à l’Afrique du Sud ou à ceux du Maghreb qui disposent d’un pouvoir de négociation plus important. Mais en définitive, la mise en place de ce type d’aide publique au développement devient un instrument de soft power de la diplomatie chinoise.
Les autorités chinoises ont développé deux types de mécanismes : tout d’abord, elles octroient des dons et des prêts sans intérêts, ainsi qu’une assistance technique. Elles accordent par ailleurs des remises de dettes, ce qui représente environ 70% du total de l’aide. Ensuite, elles proposent des prêts à taux préférentiels réservés aux projets industriels et aux infrastructures. Ces derniers sont impérativement remboursés à un taux variable et selon une durée modifiable, la moyenne observée se situant toutefois autour de 2% sur dix à quinze ans. Cette nouvelle modalité a été introduite en 1995 avec la création de la China Ex-Im Bank. Placée sous la double tutelle du MOFCOM (ministère du Commerce) et de celui des Affaires étrangères, cette banque profite des 3 500 milliards d’euros de réserves en devises chinoises (soit un tiers des liquidités de la planète) et fait par conséquent figure de bras financier de la politique étrangère. Notons que la puissance de cette institution se trouve renforcée par la contribution de quatre organismes distincts qui gèrent la politique d’aide : le MOFCOM, le ministère des Affaires étrangères, la CAD Fund (China-Africa Development Fund) et la SINOSURE (China Export and Credit Insurance Corporation). En outre, ces entités reçoivent l’appui des collectivités territoriales qui jouent un rôle majeur dans la gestion de ce processus.
Signalons cependant que cette stratégie ne bénéficie d’aucune instance centrale pour coordonner ces acteurs. Or, des divergences entre intérêts publics et privés apparaissent de manière récurrente. En effet, ces organismes forment les piliers d’un État développeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Dans cette perspective, il est donc conduit à collaborer de plus en plus avec des acteurs privés devenus incontournables au point d’infléchir l’ensemble de sa politique.
Certes, l’irruption de la Chine sur la scène mondiale a stimulé la concurrence entre les grands groupes nationaux et transnationaux. Certes, la RPC représente désormais pour les pays en développement, un contrepoids à la présence politique et idéologique des Occidentaux. Il faut néanmoins s’interroger sur l’attractivité qu’exerce aujourd’hui le modèle chinois car en réalité, sa politique d’emprise contribue à endetter de manière préoccupante certaines nations, telles que l’Éthiopie, la RDC, l’Angola ou encore le Ghana. En outre, le recours massif à la main-d’œuvre chinoise, accompagnée de l’arrivée incontrôlée de migrants, soulève des critiques dans ces régions qui connaissent déjà des taux élevés de chômage. De plus, la qualité des produits ainsi que celle des infrastructures chinoises sont souvent remises en cause. Enfin, des compagnies chinoises se retrouvent impliquées dans nombre de scandales de corruption. Principalement actives dans le secteur du BTP, elles affectent substantiellement l’image de la puissance chinoise et brouillent le message que cette dernière destine pourtant aux pays en développement. La Chine se voit donc dès lors obligée de s’adapter plus finement aux contraintes complexes d’une Afrique fragmentée et instable.
Références
Benberrah Moustafa, « L’asymétrie sociopolitique d’une coopération économique. L’implantation dominatrice des firmes chinoises en Algérie », Passage au crible, (127), 29 mai 2015. Disponible sur : http://urlz.fr/3wcs
Cabestan Jean Pierre, « La Chine et l’Éthiopie : entre affinités autoritaires et coopération économique », Perspectives chinoises, (4), 2012, pp. 57-68.
Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy 1925-1975, Stanford, Stanford University Press, 1982.
Gabas Jean-Jacques, Chaponnière Jean-Raphaël (Éds), Le Temps de la Chine en Afrique, Paris, Karthala, , 2012.
OCDE, « Perspectives économiques de l’OCDE », OCDE, (73), 2003.
Pairault Thierry, Talahite Fatiha (Éds), Chine-Algérie, une relation singulière en Afrique, Paris, Riveneuve éditions, 2014.
Nov 17, 2016 | Diplomatie non-étatique, Humanitaire, Passage au crible, Santé publique mondiale
Par Clément Paule
Passage au crible n° 149
> Versión en español
 Source: Wikipedia
Source: Wikipedia
La victoire de Donald Trump lors de la présidentielle états-unienne de 2016 marque la fin d’une joute électorale particulièrement âpre et conflictuelle. En l’occurrence, la campagne de sa rivale Hillary Clinton a été entachée de nombreuses controverses, à commencer par l’affaire des e-mails – l’utilisation d’un serveur privé de messagerie lorsqu’elle dirigeait le Département d’État. Alimenté par des piratages informatiques ayant ciblé le DNC (Democratic National Committee) et des proches de la candidate démocrate, le site WikiLeaks a ainsi publié quelques milliers de documents pendant l’été 2016. Ces fuites ont nourri les polémiques sur la Fondation Clinton – devenue, en 2013, la Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation –, dont le camp républicain a stigmatisé les méthodes de collecte de fonds. Or, de telles réserves avaient été formulées dès 2008, alors qu’Hillary Clinton s’apprêtait à occuper le poste de Secrétaire d’État au sein de l’administration Obama. Malgré la signature préalable d’un mémorandum d’entente visant à prévenir tout conflit d’intérêts, l’ex-sénatrice de New York a évolué pendant quatre ans dans une configuration inédite de pouvoir. Dans ces conditions, la fondation a été citée dans plusieurs procédures et ferait même l’objet d’enquêtes du FBI (Federal Bureau of Investigation) selon le Wall Street Journal.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Créé juridiquement en 1997 pour gérer l’édification d’un musée en Arkansas, cet organisme philanthropique est étroitement lié à la trajectoire post-présidentielle de Bill Clinton. En janvier 2001, ce dernier quittait la Maison Blanche après un deuxième mandat altéré par le scandale Lewinsky. Depuis lors, l’ancien chef de l’État s’est efforcé de réhabiliter son image en maintenant une intense activité publique. Parallèlement au soutien à la carrière de son épouse, mentionnons son implication dans la réponse humanitaire à Aceh – détruite par le tsunami du 26 décembre 2004 – ou dans la reconstruction de la Nouvelle-Orléans, après le passage de l’ouragan Katrina. Ces engagements multiples s’appuient sur la mobilisation constante d’un cercle de fidèles regroupant de jeunes collaborateurs – comme Laura Graham et Douglas Band – et des conseillers de longue date à l’instar de Bruce Lindsey ou Ira Magaziner. Ceux-ci animent le développement de la Fondation Clinton qu’ils ne tardent pas à transformer en une marque d’envergure mondiale.
En témoigne le lancement en septembre 2005 de la CGI (Clinton Global Initiative), vitrine de l’institution. Chaque année, Bill Clinton préside cette réunion de leaders internationaux – dirigeants nationaux, artistes et chefs d’entreprises – en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Très prisée des médias, cette rencontre – dont l’accès reste très onéreux – permet de consolider un puissant réseau de donateurs. Ce dernier compte des gouvernements – depuis l’Arabie Saoudite jusqu’à la Norvège –, mais aussi des milliardaires – comme Carlos Slim, Rupert Murdoch ou Denis O’Brien – et des stars hollywoodiennes. Les membres de la CGI sont invités à s’engager pour des initiatives novatrices alliant l’ingénierie sociale à la rationalité mercantile. À cet égard, l’essor fulgurant de la Fondation Clinton peut être mesuré à l’aune de ses ressources humaines – plus de deux mille employés dans une trentaine de pays en 2016 – et financières. Une enquête récente du Washington Post estimait que les contributions reçues entre 2001 et 2015 s’élevaient à deux milliards de dollars, dont 262 millions pour la seule année 2013.
Cadrage théorique
1. Une coalition philanthropique bâtie sur le capital politique des Clinton. La fondation semble opérer comme un intermédiaire – broker – entre plusieurs univers : les milieux internationaux d’affaires, le système onusien, l’arène diplomatique, le show-business ou encore le secteur non-lucratif. Dans cette logique, il s’agit de promouvoir des projets caritatifs à la fois rentables et visibles, dont les succès escomptés bénéficient en retour à la notoriété de la dynastie Clinton.
2. L’opacité d’un chevauchement structurel. La différenciation des positions – et surtout, la distinction public/privé – paraît s’estomper au sein de ce circuit d’obligés où s’échangent des biens matériels et symboliques. Entretenue à tous les niveaux, cette ambivalence concentre les suspicions, alors que se précisent les ambitions présidentielles d’Hillary Clinton.
Analyse
Notons que la Fondation Clinton intervient aussi bien aux États-Unis que dans le monde, selon des thématiques très diverses incluant la santé publique, les droits des femmes et la lutte contre le réchauffement climatique. Ce vaste mandat est décliné dans une constellation de programmes autonomes, à l’instar de la CHAI (Clinton Health Access Initiative). Adoptant la doctrine du smart power promue par Hillary Clinton au Département d’État, l’organisation revendique une approche fondée sur l’innovation, la flexibilité et les résultats obtenus. Contrairement à des pratiques plus traditionnelles, la fondation finance peu d’autres acteurs et délaisse les activités opérationnelles, en privilégiant la négociation en amont de partenariats, notamment auprès des firmes transnationales. À telle enseigne qu’un article du New York Times la décrit comme une compagnie globale de consulting à but non lucratif, explorant de nouveaux marchés dans les pays du Sud pour le compte de son réseau de donateurs. Parmi ses réussites indéniables, signalons la forte baisse du prix de certains traitements médicaux – à titre d’exemple, les antirétroviraux au Rwanda – par le biais d’accords assurant régulièrement des commandes conjointes aux laboratoires pharmaceutiques. Toutefois, de telles méthodes ont également rencontré des échecs cuisants, comme le montrent les efforts entrepris en Haïti – en particulier, le parc industriel de Caracol – après le séisme du 12 janvier 2010.
Au-delà de ce bilan mitigé, l’entité philanthropique suscite d’autant plus d’appréhensions qu’Hillary Clinton a dirigé la politique étrangère des États-Unis entre 2009 et 2013. De nombreux commentateurs ont pointé le risque d’un accès au gouvernement à la carte – pay-to-play –, doublant les canaux traditionnels du lobbying institutionnel. Quelques sommes reçues par la Fondation Clinton n’auraient pas été déclarées au Département d’État, dont un demi-million de dollars que le gouvernement algérien avait alloué à l’urgence humanitaire en Haïti. Signalons en outre que certains médias se sont interrogés sur les opérations commerciales d’un bailleur majeur de la CGI, le milliardaire canadien Frank Giustra. Plus encore, la banque suisse UBS aurait significativement augmenté ses contributions à l’organisme caritatif après le règlement de son contentieux avec le fisc états-unien – l’IRS (Internal Revenue Service) – sous les auspices d’Hillary Clinton. Autant d’éléments relayés, à l’approche de l’élection présidentielle de 2016, par le Wall Street Journal ou le site ultra-conservateur Breitbart News, par ailleurs à l’origine d’un livre à charge intitulé Clinton Cash. Outre les soupçons d’enrichissement personnel – les conférences rémunérées auraient rapporté plusieurs dizaines de millions de dollars à la famille Clinton –, cette offensive partisane vise à dépeindre un système élitiste de corruption au sommet de l’État fédéral.
Face à ces allégations, la fondation s’est contentée d’affirmer son apolitisme tandis que ses défenseurs, à l’instar de l’économiste Paul Krugman, stigmatisaient un acharnement idéologique contre des personnalités très exposées. S’il faut constater qu’aucune preuve irréfutable – smoking gun – n’a pour l’heure été apportée, les tensions internes à l’organisation semblent néanmoins perpétuer un déficit chronique de transparence. À partir de 2011, l’ascension de Chelsea Clinton au sein de l’institution a rencontré la résistance de certains collaborateurs historiques comme Douglas Band. Initiateur de la CGI, ce dernier aurait alors été accusé de monnayer l’accès à Bill Clinton et d’utiliser cette position privilégiée pour développer Teneo, sa propre société de conseil. De telles pratiques se retrouvent pourtant dans l’entourage d’Hillary Clinton : ses proches Cheryl Mills – créatrice du BlackIvy Group – et Huma Abedin ont parfois occupé simultanément des postes dans l’administration fédérale et la Fondation Clinton. Dépassant l’extrême polarisation de la campagne électorale, cette porosité structurelle pourrait indiquer une redéfinition par le haut des limites du champ politique. Dès lors, la façade philanthropique ne saurait occulter cette recomposition du pouvoir, reposant en dernière instance sur l’intrication étroite de puissants intérêts.
Références
Bishop Matthew, Green Michael, Philanthrocapitalism. How Giving Can Save the World, New York, Bloomsbury Press, 2009.
Clinton William J., Giving: How Each of Us Can Change the World, New York, Knopf, 2007.
Fahrenthold David A., Hamburger Tom, Helderman Rosalind S., « The Inside Story of How the Clintons Built a $2 Billion Global Empire », The Washington Post, 2 juin 2015.
Paule Clément, « La santé publique à l’heure du capitalisme philanthropique. Le financement dans les PVD par la Fondation Gates », Passage au crible (14), 11 fév. 2010, disponible sur : http://urlz.fr/4roD
Sack Kevin, Fink Sheri, « Rwanda Aid Shows Reach and Limits of Clinton Foundation », The New York Times, 18 oct. 2015.
Schweizer Peter, Clinton Cash: the Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich, New York, Harper Collins Publishers, 2015.
Nov 9, 2016 | Environnement, Passage au crible, Réchauffement climatique
Par Philippe Hugon
Passage au crible n°148
 Source: Flickr
Source: Flickr
La COP22 se tient du 7 au 18 novembre à Marrakech. Elle a pour objet de transformer en actions concrètes les principes établis par la COP21. Ce sommet se déroule alors que les climato-sceptiques ont quasiment disparu du champ scientifique. En revanche, leur thèse est défendue dans les pays industriels par certains mouvements populistes et des dirigeants politiques qui cherchent à capter des voix (Sarkozy en France, Trump aux États-Unis). Comme les précédentes, la COP22 est confrontée à la question de la dette climatique et de la répartition de son financement.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à Rio de Janeiro en 1992, a été mise en œuvre en 1994 par la Conference of Parties désignée sous le nom de COP.
Le protocole de Kyoto de 1997 a représenté ensuite une grande avancée. Entré en vigueur en 2005 après avoir été ratifié par 175 pays, il a retenu la « responsabilité commune et différenciée » et a introduit le principe de droits à émettre. Mais les émergents ont été exemptés des contraintes de réduction des émissions de GES (Gaz à effet de serre). Par ailleurs, ce traité n’a pas pris en en compte les « émissions virtuelles » ou les fuites de carbone liées au commerce international. Enfin, rappelons que les États-Unis ont refusé de le ratifier. Les MDP (Mécanismes du développement propre) ont été très limités en ce qui concerne l’Afrique. Quant à la réunion de Copenhague, elle a abouti à un échec en 2009.
Au contraire, l’accord onusien sur le climat signé en décembre 2015 (COP21) a enregistré un progrès. Il s’agissait de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d’ici 2050, de réduire les émissions de CO2 de 50% d’ici 2100 et de 100% d’ici 2100. Ce texte a prévu a minima un financement annuel global de 100 milliards de dollars par an pour le groupe des 77. Approuvé à l’unanimité des 196 délégations, il constitue un succès diplomatique obtenu cependant au prix d’importantes concessions, auxquelles s’ajoutent des promesses non contrôlées. Certes, il repose sur des bases justes, mais il demeure flou quant aux engagements et aux mesures concrètes à réaliser. En outre, la négociation portant sur la transparence s’est soldée par un échec. Ce document a toutefois été ratifié par les grands émetteurs de GES et un nombre suffisant d’États pour entrer en vigueur.
S’il est impossible que la COP22 puisse bénéficier du même rayonnement mondial que la COP21, elle se déroule néanmoins symboliquement au Maroc, pays modèle en matière de transition énergétique. Dans cet État, l’électricité apparaît dépendante des importations à 97% alors que la consommation d’énergie croît de 7% par an. L’objectif consiste par conséquent à fournir 52% de l’électricité grâce aux énergies renouvelables et à réduire de 32% les émissions de GES d’ici 2030. De plus, 64% des dépenses climatiques sont affectées à l’adaptation et à la transition énergétique vers les ressources renouvelables (solaire, éolienne), soit 9% des dépenses globales d’investissement.
Au sein des Nations Unies, le passage des OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) en ODD (Objectifs de Développement Durable) pour tous traduit un changement de paradigme concernant aussi bien le Nord que le Sud.
Cadrage théorique
Les Conférences climatiques renvoient à deux principales lignes de force.
1. Les stratégies déployées face aux risques climatiques. Faut-il prévenir les aléas climatiques par des stratégies proactives ou des principes de précaution ? Faut-il mettre en place des mécanismes de compensation ou favoriser plutôt l’adaptation, la résilience (capacité de répondre aux chocs) et la mitigation (atténuation des effets des dommages) ? La gestion environnementale concerne-t-elle prioritairement les acteurs locaux ou implique-t-elle l’ensemble des parties prenantes de la scène mondiale ?
2. L’absence de toute autorité supraétatique en matière climatique. Formé d’un ensemble d’États souverains, le cadre multilatéral classique apparaît peu à même de répondre aux défis environnementaux et climatiques. Il n’existe pas d’autorité supranationale ni d’organisation mondiale de l’environnement pour protéger et gérer les biens publics mondiaux.
Analyse
Il n’y a plus guère de doute dans la communauté scientifique quant à l’ampleur du changement climatique récent et futur. Le réchauffement à l’échelle mondiale est d’ores et déjà estimé en un siècle à 0,6 degré. Les phénomènes extrêmes se traduisent notamment par des sécheresses ou des inondations. Ils impliquent également la réduction à long terme des précipitations dans les régions arides. Les effets de ces aléas climatiques sont bien connus en termes de désertification, de stress hydrique, de vulnérabilité de l’agriculture, de fragilité des petites îles et des villes côtières. Enfin, ils bouleversent la santé publique et les flux migratoires à l’échelle mondiale.
Les émissions de GES ont quadruplé entre 1959 et 2014, alors que la population mondiale passait de 3 à 7,2 milliards. Elles ont augmentée de 3 à 5 tonnes par individu. On note par ailleurs un changement territorial des émetteurs. En effet, les pays développés représentaient en 1990 deux-tiers des émissions alors qu’aujourd’hui les pays du Sud – principalement les émergents – en constituent près de la moitié. En revanche, un habitant émet dans les pays du Nord 10,8 tonnes de GES alors qu’au Sud, il n’en produit que 3,5 tonnes. Pour sa part, l’Afrique subsaharienne affiche 0,87 de tonne de CO2 par habitant.
Mais ces données exprimées en termes de territorialisation des émissions doivent être corrigées de deux façons :
– Elles n’intègrent pas l’épuisement des ressources forestières (puits de carbone), des ressources énergétiques non renouvelables qui sont, pour l’essentiel, exportées. Par exemple, en Afrique, l’épargne nette ajustée (épargne nationale – (émission de CO2+ épuisement des ressources énergétiques, forestières et minérales) s’avérait négative en 2007-2009. La RDC, le Congo, le Nigeria et l’Angola témoignaient de l’épargne nette négative la plus forte.
– Elles ne prennent pas en compte l’impact du commerce extérieur et la délocalisation des émetteurs de GES dans le contexte de la mondialisation, compte tenu du contournement des normes environnementales par les firmes transnationales et du risque de dumping environnemental. De plus, il convient d’intégrer le contenu en GES des importations et des exportations puis de calculer au sein des chaînes mondiales de valeurs la composante empreinte carbone des divers segments. Reste en dernier lieu la délocalisation et l’externalisation des pollutions climatiques qui relativisent très fortement les déclarations vertueuses formulées par les territoires du Nord.
Comme les questions climatiques sont traitées indépendamment du caractère transnational des firmes, la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques se trouve largement déconnectée des négociations commerciales, notamment au sein de l’OMC, ou des accords pluri-partenariats. Il conviendrait pourtant de relier la protection de l’environnement, le commerce et l’investissement dans le cadre de la mondialisation de l’économie de marché. Or, les négociations et les accords internationaux privilégient la souveraineté nationale au lieu de prendre en compte les interdépendances existant entre les acteurs présents à diverses échelles territoriales qui vont du niveau mondial aux échelons des nations, des régions et des collectivités locales.
Par ailleurs, les transitions énergétiques diffèrent selon les stades de développement atteint par les différents pays. Les pays africains pourraient par exemple réaliser plus facilement une croissance verte grâce à la diversité de leurs partenaires, aux révolutions technologiques réduisant les coûts et à la possibilité de court-circuiter des phases, sans avoir à gérer des infrastructures lourdes fortement dépendantes des énergies fossiles. Ces passages différenciés supposeraient de s’appuyer sur des acteurs publics mais aussi non-étatiques, à la condition de bénéficier de financements ad hoc non réductibles aux transferts de fonds accaparés par des États rentiers. La COP22 doit permettre d’envisager tous ces cas de figure.
Références
Hugon Philippe, Afriques entre puissance et vulnérabilité, Paris, Armand Colin, 2016.
Nations Unies Commission économique pour l’Afrique, Vers une industrialisation verte en Afrique, New York, 2016.
Stern Nicholas, Why Are we waiting? The Logic Urgency and Process of Tackling Climate Change, Cambridge, (Mass.) MIT Press, 2015.
 Source: Chaos International
Source: Chaos International