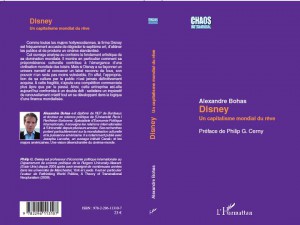Jan 20, 2010 | Ouvrages, Publications
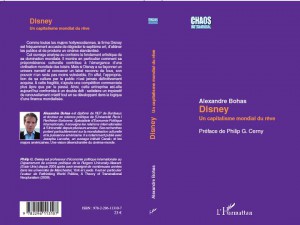
Alexandre Bohas
Préface de Philip G. Cerny
Comme toutes les majors hollywoodiennes, la firme Disney est fréquemment accusée de dégrader le septième art, d’aliéner les publics et de produire un cinéma standardisé.
Cet ouvrage analyse au contraire le fondement artistique de sa domination mondiale. Il montre en particulier comment sa prépondérance culturelle contribue à l’émergence d’une civilisation mondiale des loisirs. Mais si Disney a su façonner un univers narratif et concevoir un label reconnu de tous, son pouvoir n’en reste pas moins vulnérable. En effet, l’appropriation de sa culture par le public n’est jamais définitivement acquise. À cette fragilité, s’ajoute une compétition commerciale plus âpre que par le passé. Ainsi, cette entreprise est-elle aujourd’hui confrontée à un double défi : satisfaire un impératif de renouvellement créatif tout en se développant dans la logique d’une finance mondialisée.
Alexandre Bohas est diplômé de l’IEP de Bordeaux et docteur en science politique de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Spécialiste d’Économie Politique Internationale, il enseigne les relations internationales à l’Université depuis plusieurs années. Ses recherches portent particulièrement sur la mondialisation culturelle et la puissance américaine. Il a notamment publié avec Josepha Laroche, un ouvrage intitulé Canal+ et les majors américaines. Une vision désenchantée du cinéma-monde.
Philip G. Cerny est professeur d’économie politique internationale au Département de science politique de la Rutgers University-Newark (États-Unis) depuis 2004 après avoir enseigné de nombreuses années dans les universités de Manchester, York et Leeds. Il est en particulier l’auteur de Rethinking World Politics, A Theory of Transnational Neopluralism (2009).
Commander l’ouvrage
Jan 18, 2010 | Nord-Sud, Passage au crible, Santé publique mondiale
Par Clément Paule
Passage au crible n°11

Source : Pixabay
La réforme du système de santé américain s’est heurtée en janvier 2010 à l’opposition des firmes pharmaceutiques regroupées dans le PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). Ces industriels refusent que la durée de douze ans, pendant laquelle ils détiennent un monopole d’exploitation sur leurs produits, soit réduite comme le désire le président Barack Obama. Ils menacent donc la Maison Blanche et le Congrès de « retirer leur soutien » au projet de loi. Cette annonce évoque implicitement les ressources considérables de ces acteurs privés, notamment en matière de lobbying auprès des parlementaires. Cible de nombreuses critiques, l’industrie pharmaceutique représente un secteur atypique : 1) Par les profits qu’elle engrange chaque année : en dépit de la crise financière, IMS (Intercontinental Medical Statistics) Health évaluait par exemple le marché mondial des médicaments en 2008, à 770 milliards de dollars. 2) Par la spécificité des biens produits qui revêtent une visée thérapeutique universelle et s’avèrent de la sorte intimement liés aux systèmes de protection sociale.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Longtemps artisanale, la fabrication de produits pharmaceutiques s’est transformée en une véritable industrie à la fin du XIXe siècle. L’apport de la chimie accélère alors le rythme des innovations thérapeutiques. Mentionnons à cet égard, l’aspirine découverte par Bayer vers 1895 ou bien encore, les pénicillines de synthèse. Mais l’essor mondial de ces entreprises a débuté après 1945, lorsque des firmes américaines comme Pfizer se sont internationalisées, profitant de la création des systèmes de protection sociale. En fait, la deuxième moitié du XXe siècle se caractérise par l’émergence de concurrents européens et japonais et la constitution de puissantes multinationales de la pharmacie.
Depuis les années quatre-vingt, on observe un mouvement de concentration dans ce secteur, mouvement qui tend vers une intégration mondiale de la production. Ainsi, les deux géants britanniques GlaxoWellcome et SmithKlineBeecham PLC fusionnent-ils en 2000 pour 75,9 milliards de dollars, tandis que Pfizer rachète Wyeth en 2009 pour 68 milliards de dollars. Cette restructuration consacre la domination d’une vingtaine de laboratoires appelés big pharma, majoritairement 1) américains – Johnson & Johnson, Merck –, 2) européens – Sanofi-Aventis (France), Novartis (Suisse), AstraZeneca (anglo-suédois) – et 3) japonais (Takeda). Quant au reste du secteur, il se compose de structures moyennes très spécialisées, de firmes biotechnologiques et de fabricants de génériques.
Cadrage théorique
L’économie politique internationale met particulièrement bien en relief les effets de la globalisation de l’industrie pharmaceutique, et notamment l’impact normatif de ses acteurs sur les politiques nationales de santé publique.
1. La puissance structurelle (structural power). Ce concept, proposé par Susan Strange ; permet d’éclairer le rôle international de ces intervenants économiques non-étatiques. En occupant des positions dominantes dans les structures de production et de finance, mais aussi dans celles de la sécurité et des savoirs, les big pharma réussissent à orienter le contenu des normes sanitaires ainsi que leur diffusion.
2. Diplomatie non-étatique et diffusion normative. Grâce aux diverses ressources dont elle dispose –comme le lobbying – l’industrie pharmaceutique exerce un fort impact sur les négociations internationales et les politiques de santé publique de chaque État.
Analyse
Concentration et financiarisation d’un secteur oligopolistique. Le groupe des big pharma évolue au rythme des fusions-acquisitions, nécessaires pour compenser le ralentissement récent de l’innovation et soutenir des budgets de recherche croissants. Les OPA (Offres Publiques d’Achat) hostiles, la rivalité transatlantique et les stratégies de prédation coexistent cependant avec une tendance à la cartellisation, aux partenariats, voire à la collusion. C’est ainsi qu’en 2001, 8 laboratoires ont été condamnés par la Commission européenne à une amende de 850 millions d’euros pour une entente illicite portant sur la vente de vitamines. De même, le co-marketing – accord visant à conquérir des marchés étrangers – reste une pratique répandue entre les grandes firmes souvent capitalisées en bourse.
Lobbying international pour la propriété intellectuelle. Le poids financier du secteur s’exprime sur le plan mondial dans le cadre de l’IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations). Les big pharma soutenues par leurs États d’origine y défendent surtout la propriété intellectuelle, vitale pour une industrie fondée sur l’invention. Dans cette logique, cette fédération a joué, au milieu des années quatre-vingt-dix, un rôle décisif dans les négociations de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) portant sur les ADPIC (Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce). Ces accords sont apparus vitaux pour les grandes firmes qui cherchent à maintenir un monopole d’exploitation sur leurs médicaments les plus rentables, notamment face aux pays émergents. En l’occurrence, il s’agissait d’entraver la diffusion des génériques, copies moins onéreuses de produits pharmaceutiques tombés dans le domaine public. En 1998, 39 laboratoires ont même intenté un procès au gouvernement sud-africain pour violation des droits sur la propriété intellectuelle. Ils furent cependant contraints de retirer leur plainte trois ans plus tard, lorsqu’ils perdirent le soutien des pays occidentaux après la campagne médiatique menée par de nombreuses ONG. Autrement dit, les firmes ne peuvent se passer du soutien de certains acteurs étatiques, avec lesquels elles entretiennent des relations variables qui vont du protectionnisme économique – la France et Aventis en 2004 – au conflit ouvert lorsqu’il s’agit de réformer les systèmes de santé.
Multiples impacts sur les politiques de santé des États. Malgré ces tensions, l’industrie pharmaceutique se présente comme un puissant producteur de normes en raison de son emprise sur la recherche et de sa maîtrise du marketing. En effet, les grandes firmes participent à la définition en amont des problèmes de santé publique, n’hésitant pas à médicaliser des comportements qui jusque-là n’étaient pas perçus comme pathologiques. L’invention de maladies – comme le vieillissement physiologique –, apparaît ensuite comme une solution face au déficit d’innovation thérapeutique. La diffusion mondiale des produits ainsi créés est alors assurée par les activités promotionnelles et le lobbying effectué auprès des professionnels de la santé, voire des patients eux-mêmes par le biais de programmes d’observance et de traitements préventifs.
Des logiques économiques en contradiction avec les objectifs de santé publique. Les laboratoires participent à l’accentuation des disparités mondiales car ils concentrent leurs investissements sur les pathologies les plus rentables – cancer, maladies cardiovasculaires – pour assurer leur présence sur les marchés américain ou européen. Or, ce choix stratégique s’effectue au détriment des maladies infectieuses ravageant les pays en développement.
Enjeux d’une régulation mondiale. Si le secteur reste certes réglementé par quelques grandes agences étatiques, comme la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis ou l’EMEA (Agence européenne des médicaments) pour l’Union Européenne, aucune institution n’est en revanche chargée de cette tâche à l’échelle mondiale. Pour l’heure, s’ils existent, les organes de contrôle ne disposent pas de budget comparable et agissent uniquement en aval, délivrant des AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) avec des essais cliniques effectués par l’industrie. Dès lors, le médicament semble obéir aux logiques d’un marché très lucratif, et la santé faire davantage office de simple produit commercial que de bien public mondial.
Références
Abécassis Philippe, Coutinet Nathalie, « Caractéristiques du marché des médicaments et stratégies des firmes pharmaceutiques », Horizons stratégiques, (7), 2008, pp. 111-139.
Hamdouch Abdelilah, Depret Marc-Hubert, La Nouvelle économie industrielle de la pharmacie : structures industrielles, dynamique d’innovation et stratégies commerciales, Paris, Elsevier, 2001.
Juès Jean-Paul, L’Industrie pharmaceutique, Paris, PUF, 1998. Coll. Que sais-je ?
Pignarre Philippe, Le Grand secret de l’industrie pharmaceutique, Paris, La Découverte, 2003.
PwC (PricewaterhouseCoopers), Pharma 2020 : the Vision – Which Path will you Take ?, 2007, consulté le 14/01/2010 sur le site de PwC : http://www.pwc.com/gx/en/pharma-life-sciences/pharma-2020/pharma-2020-vision-path.jhtml
Déc 26, 2009 | Migrations internationales, Multilatéralisme, Passage au crible
Par Catherine Wihtol de Wenden
Passage au crible n°10

Source : Pixabay
Au cours de la première semaine de novembre 2009, s’est tenu à Athènes le troisième Forum Mondial sur les Migrations et le Développement. Il succède à ceux tenus sur le même thème à Bruxelles en 2007 et Manille en 2008. Ce sommet traduit un projet de gouvernance mondiale des migrations associant pays de départ, pays d’accueil, OIG, ONG, associations, syndicats, patronats et experts.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
En 1994, la Conférence mondiale du Caire sur la population a mentionné, pour la première fois, les migrations comme sujet d’intérêt international. Dix ans plus tard, à la suite du GMG (Geneva Migration Group, devenu Global Migration Group), le Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, a soutenu cette initiative avec l’instauration du dialogue de Haut Niveau qui s’est tenu à New York en 2006 et qui a ensuite permis la création des Forums annuels migration et développement. En l’espèce, il s’agissait de faire obstacle aux dérives des politiques intergouvernementales des seuls pays d’accueil. En effet, ces derniers ont toujours mis l’accent sur le contrôle des frontières, ce qui a produit de multiples effets pervers et a gravement porté atteinte aux droits de l’Homme.
Dès 2004, des organisations internationales – le GMG, le HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés), l’OIT (Organisation Internationale du Travail et l’OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) – ont proposé d’élaborer un mécanisme multilatéral visant à développer une plateforme commune en matière de politiques migratoires. En l’occurrence, considérant les entraves à la mobilité comme une perte économique, sociale, culturelle pour les pays d’accueil, de départ et les migrants eux-mêmes, elles entendaient sécuriser la mobilité à l’échelle mondiale et transformer celle-ci en facteur de développement.
Cadrage théorique
Le processus apparaît double. D’une part, il définit les migrations comme un BPM (Bien Public Mondial), enjeu de gouvernance globale. D’autre part, il promeut le multilatéralisme comme méthode de négociation entre des acteurs aux intérêts opposés.
1. Les migrations, Bien Public Mondial. Les travaux d’experts ont montré que la mobilité constituait un élément essentiel du développement humain. Afin de réduire les inégalités à l’échelle de la planète, ils ont indiqué qu’il conviendrait par conséquent d‘accompagner politiquement la mobilité pour en faire un BPM (Bien Public Mondial).
2. Le multilatéralisme, comme méthode. Dans le cadre des Nations unies, le compromis a consisté en 2006 à associer migration et développement, deux notions au cœur des forums mondiaux qui ont suivi. Soulignons trois lignes de force : 1) Un dialogue sur les migrations et le développement peut s’engager à condition qu’existe un échange entre des positions contradictoires. 2) La migration doit être traitée en lien avec le développement, sans se centrer exclusivement sur les retombées économiques des transferts de fonds des migrants, mais en s’attachant plutôt à l’innovation et à la liberté, facilitées par la mobilité. 3) Il importe de se concentrer sur les mesures opérationnelles qui permettent de gérer les migrations de manière positive, dans une démarche gagnant-gagnant-gagnant aussi bien pour les pays d’accueil et de départ que pour les migrants eux-mêmes. Le multilatéralisme offre aussi l’occasion pour les différents protagonistes de mettre en avant la dimension largement transnationale des flux migratoires et des comportements des migrants qui en résultent. Ce faisant, il met également en relief la constitution de réseaux économiques, familiaux, sociaux et culturels. Cette diplomatie des migrations permet de dépasser l’approche sécuritaire qui ne veut voir dans les migrations que le passage et le contrôle des frontières, que les atteintes à la souveraineté étatique.
Analyse
Les trois forums tenus respectivement à Bruxelles, Manille et Athènes ont réuni séparément les États d’immigration et d’émigration et le monde associatif – 1000 participants à Athènes, associations de migrants, associations de défense des droits, experts, syndicats, employeurs, associations de développement. Quant aux intérêts de ce dernier, ils demeurent dispersés, voire contradictoires. Aussi, la plupart des associations ainsi que les pays de départ ont-ils concentré l’essentiel de leur mobilisation autour de la signature, par les États du Nord, de la Convention de 1990. Ce traité, qui inclut également des droits pour les migrants en situation irrégulière, énonce ceux de tous les travailleurs migrants – y compris les sans-papiers – et de leurs familles. Entré en vigueur en 2003, il comporte par ailleurs des articles propres à la coopération internationale. Mais il s’agit pour l’heure d’un échec, car les 42 États signataires sont tous du Sud. Les syndicats considèrent en outre qu’il procède d’une diplomatie parallèle au terme de laquelle les représentants des sociétés civiles ont été cooptés et marginalisés. Enfin, ils estiment que les discussions entre les associations de diasporas et les ONG ont manqué de clarté et dénoncent un processus organisé en dehors des Nations unies.
Cependant, de grandes organisations telles que le HCR, l’OIM, l’ICMC (Comité International Catholique pour les Migrants) et l’OIT (Organisation Internationale du Travail) ont tiré un bilan positif de l’exercice, mettant plutôt l’accent sur sa dimension progressive. En effet, alors que le Forum de Bruxelles avait souligné la pertinence de la démarche en termes de droits de l’Homme, celui de Manille s’est, pour sa part, penché sur leur mise en pratique. Quant au sommet d’Athènes, il a posé la question sous l’angle du développement des pays d’origine et de destination.
Les principales propositions qui ont été avancées par les protagonistes à Athènes sont les suivantes : 1) Intégrer la migration parmi les stratégies de réduction de la pauvreté. 2) Assurer une cohérence et une meilleure coordination entre migration et développement à l’échelon des politiques nationales. 3) Collecter des données sur les migrations circulaires dans les pays d’origine et d’accueil. 4) Réunir les profils migratoires et les expériences de réintégration au pays, en y incluant les diasporas. 5) Comparer les pratiques d’intégration et de protection sociale les plus satisfaisantes. 6) Baisser le coût des transferts de fonds. 7) Étudier l’effet de ceux-ci sur le mieux être des populations restées au pays. 8) Analyser l’impact du changement climatique sur la migration. 9) Traiter de l’ensemble de ces points dans un souci de bonne cohérence institutionnelle.
Pour autant, quelles peuvent être les perspectives d’un tel Forum ? A minima, les acteurs de la société civile, se sont entendus pour éviter à l’avenir la politique de la chaise vide. Pour le prochain Forum, qui se tiendra à Mexico en 2010, ils envisagent de créer un espace de débat global, plus légitime et plus crédible. Dans la même logique, la requalification de certains concepts devenus trop flous –notamment ceux de pays de départ, d’accueil et de transit – sera inscrite à l’ordre du jour. Mais, comme en matière migratoire, la symbolique reste capitale, l’inclusion des Nations unies – et donc du HCR – sera déterminante pour donner plus de poids à cette initiative. D’ores et déjà, on comprend bien qu’une gouvernance mondiale des migrations ne pourra se réaliser qu’à ce prix.
Références
ICRMW – (International Steering Committee for the Campaign for Ratification of the Migrants Rights Convention) (Ed.), Guide on Ratification International Convention of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families, Geneva, April 2009.
PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement (Éd.), Rapport mondial sur le développement humain. Lever les barrières : mobilité et développement humains, New York, PNUD, 2009.
Wihtol de Wenden Catherine, La Globalisation humaine, Paris, PUF, 2009.
Déc 19, 2009 | Biens Publics Mondiaux, Environnement, Passage au crible
Par Simon Uzenat
Passage au crible n°9

Source : Pixabay
Du 7 au 19 décembre 2009 s’est tenue à Copenhague la 15ème CdP (Conférence des Parties) sous l’égide de la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques). Il s’agissait de parvenir à l’adoption d’un instrument juridique contraignant sur le plan international afin 1) de réduire la production mondiale de gaz à effet de serre (GES) et 2) d’adapter les modèles de développement aux conséquences prévisibles du changement climatique. L’échec de ce sommet ne doit cependant pas occulter l’émergence de structures originales de gouvernance des Biens Publics Mondiaux.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
La réponse internationale aux changements climatiques a pris forme avec l’adoption en 1992 de la CCNUCC. Cette dernière a établi le cadre institutionnel visant à stabiliser les concentrations atmosphériques des GES. En décembre 1997, les délégués à la troisième CdP se sont ensuite accordés à Kyoto sur un protocole qui engageait les pays industrialisés – mentionnés dans l’Annexe I – à réduire d’ici 2012 leurs émissions globales de GES d’une moyenne de 5,2%, en deçà de leurs niveaux de 1990. Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005 et arrivera à échéance le 31 décembre 2012, sans être pour l’heure ratifié par la première puissance émettrice de GES par habitant, les États-Unis.
En décembre 2008 à Poznań, lors de la 14e CdP, le Secrétaire exécutif de la CCNUCC, a déclaré que « 50 à 80% des actions concrètes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et quasiment 100% des mesures d’adaptation aux conséquences du changement climatique sont conduites à un niveau infra-étatique ». En septembre 2009, pendant la semaine du climat, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a tenu à souligner le rôle des entités subnationales. Pour leur part, les animateurs du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat) insistent sur les disparités territoriales qu’entraîne le changement climatique. Selon leurs travaux, les régions littorales, les petites îles et, plus généralement, les PMA (Pays les Moins Avancés) subiront 80% des dommages dont les pays riches assument pourtant 80% de la responsabilité.
Comme les autres acteurs périphériques des négociations, les régions se sont regroupées au sein de réseaux transnationaux plus ou moins spécialisés. Le premier d’entre eux, nrg4SD (Network of Regional Governments for Sustainable Development), a vu le jour lors du sommet du millénaire, à Johannesburg, en 2002 et calque l’organisation de ses événements sur le calendrier de la CCNUCC. Il a ainsi adopté une première déclaration sur le changement climatique en 2005 à Montréal et s’est ensuite fortement impliqué dans la CdP 14 de Poznań. Dans la même logique, on a créé en 2007 à Marseille, le FOGAR (FOrum Global des Associations de Régions).
À la différence des autres acteurs non-étatiques, les régions bénéficient d’un statut particulier. En effet, dans les conférences internationales, les provinces belges, les Länder allemands ou, dans une moindre mesure, les provinces espagnoles et canadiennes, siègent au sein même de leur délégation nationale. Elles peuvent alors déposer des soumissions (amendements) directement auprès du Secrétariat de la CCNUCC et contribuer, de ce fait, aux différentes étapes des négociations. À cet égard, les réseaux de régions – considérés comme des ONG par l’ONU et disposant à ce titre du statut d’observateur – bénéficient indirectement et partiellement du pouvoir relationnel de certains de leurs membres.
Cadrage théorique
L’implication des régions dans les négociations internationales sur le changement climatique met en jeu deux problématiques au cœur du processus de mondialisation.
1. Les diplomaties non-étatiques. De très nombreuses politiques définies et mises en œuvre au plan régional – quelle que soit la nature des relations entre l’État central et les collectivités locales – demeurent étroitement liées à la question du changement climatique (transports, habitat, énergie…). Ce faisant, elles contribuent à transformer la nature des rapports entre les deux niveaux de gouvernance, notamment au regard de la participation de l’échelon local aux négociations internationales. En l’espèce, soulignons ici le rôle central joué par l’Union européenne dans la reconnaissance du droit à agir des autorités locales sur la scène internationale, en particulier grâce aux fonds spécifiques qu’elle déploie. Cette diplomatie non-étatique revêt par ailleurs une forme syncrétique qui combine les répertoires d’action propres aux ONG, aux firmes transnationales et aux États.
2. Les biens publics mondiaux. En tant que Bien Public Mondial pur, le climat représente l’un des enjeux majeurs d’une gouvernance mondiale actuellement en chantier. Les problèmes globaux, tels qu’ils sont perçus aujourd’hui, ne peuvent en effet plus être réglés par la seule voie de la coopération interétatique. Ils appellent au contraire la coordination d’actions décentralisées et majoritairement non-étatiques. Cette approche permet, paradoxalement, de relégitimer l’intervention publique à l’échelle internationale, tout en démontrant la nécessité de dépasser le cadre intergouvernemental.
Analyse
L’élaboration, la définition et la mise en œuvre de politiques publiques de l’environnement engagent désormais tous les échelons infra-étatiques, au premier rang desquels figure le niveau régional. Dans un article consacré à la diffusion de l’autorité de l’État, Susan Strange appelait, dès 1995, à se pencher sur la question de la diffusion du pouvoir de l’État central vers les entités sub-étatiques. Dans le même temps, le retrait de la puissance étatique, de ses moyens de régulation et d’intervention se sont accélérés. En fait, ils précèdent souvent la recomposition de la scène gouvernementale en abaissant les coûts d’entrée d’acteurs jusque-là marginalisés. Dans une logique wébérienne, l’État est alors conduit à décentraliser et externaliser certaines de ses politiques opérationnelles, tout en organisant une recentralisation de la décision. Mais par voie de conséquence, ces dynamiques contribuent à autonomiser et affaiblir les organisations internationales. En effet, l’intrusion de nouveaux joueurs constitue pour celles-ci l’opportunité de diversifier leurs relais d’intermédiation. Cependant, cela menace aussi leur prétention à incarner une gouvernance mondiale.
Le fonctionnement des réseaux internationaux de collectivités locales demeure néanmoins fragilisé par les inégalités et les différentiels de développement qui caractérisent la mondialisation. Ce constat se vérifie plus encore à mesure qu’ils sont rejoints par davantage de régions du Sud, très faiblement dotées et souvent marginalisées au sein de pays eux-mêmes dominés.
La principale ressource de ces entités infra-étatiques consiste à s’adapter aux propriétés et aux contraintes de la mondialisation, semblable en cela aux firmes transnationales. Ceci peut prendre par exemple la forme d’une recherche d’économies d’échelle, d’une multiplication de partenariats public-privé ou bien encore de plans globaux de communication. Lors de la conférence de Copenhague, 60 leaders régionaux ont ainsi participé le 15 décembre au Climate Leaders Summit 2009, piloté par The Climate Group. En l’occurrence, il s’agit d’un club international – fondé sous l’égide de Tony Blair – et qui regroupe une cinquantaine de représentants des plus grandes firmes mondiales à laquelle s’ajoute une trentaine de gouvernements régionaux, dont la Californie, le Québec et la Bavière. À cet égard, on observe bien que l’action collective s’inscrit probablement plus dans une logique de responsabilité que dans une logique classique de souveraineté. Un tel affranchissement de l’hétéronomie étatique ne doit toutefois pas être compris comme abandon ou refoulement du cadre stato-national, dont les conclusions de Copenhague montrent au contraire la prégnance. Il convient plutôt de l’appréhender dans le cadre d’un processus plus vaste de dissémination de l’autorité politique.
Références
Hocking Brian, « Patrolling the “Frontier” Globalization, Localization, and the “Actorness” of Non-Central Governments », in: Francisco Aldecoa, Michael Keating (Eds), Paradiplomacy in Action. The Foreign Relations of Subnational Governments, Regional and Federal Studies, 9 (1), Spring 1999, pp. 17-39.
Ollitrault Sylvie, Militer pour la planète, Rennes, PUR/Res Publica, 2008.
PNUD (Ed.), La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé, Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008. Consultable à l’adresse : http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/
Strange Susan, « The Defective State », Daedalus, 124 (2), Spring 1995, pp. 55-74.
Déc 7, 2009 | Finance internationale, Nord-Sud, Passage au crible
Par Florent Bédécarrats
Passage au crible n°8

Source : Shutterstock
Le FOROLAC (Forum Latino-américain et des Caraïbes de Finances Rurales) rassemble environ 350 IMF (institutions de microfinance) desservant plus de 2,5 millions d’usagers sur ce continent. En partenariat avec le gouvernement du Brésil, le FOROLAC a organisé en décembre 2009 un séminaire sur le thème suivant : Agricultures familiales, souveraineté alimentaire et systèmes financiers ruraux : défis et opportunités face à la crise. Cet événement international a réuni 600 participants représentant tout à la fois des ONG, des mouvements sociaux, des gouvernements, des banques publiques, des coopératives et des entreprises privées.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et les indépendances, la plupart des États du Sud ont mis en place des banques publiques pour financer leur développement. Toutefois, ces établissements ont pâti de nombreux dysfonctionnements et d’instrumentalisations clientélistes. Obligeant les gouvernements à les recapitaliser régulièrement, ils ont contribué à l’aggravation des déficits et de l’endettement des pays en développement. Avec la crise financière de 1982, les IFI (Institutions Financières Internationales) – prêteurs en dernier recours – ont dû renflouer les États en cessation de paiement, en imposant une série de conditionnalités. Ils ont en particulier exigé la libéralisation des systèmes financiers, la réduction des dépenses publiques et le démantèlement des banques de développement.
La microfinance s’est ensuite déployée dans l’espace social dénié par les politiques d’ajustements structurels. Sa mise en œuvre a progressivement été centralisée par des organisations spécialisées qui ont diversifié leurs offres, en proposant des services d’épargne ou d’assurance ainsi que des transferts nationaux et internationaux. À partir du milieu des années quatre-vingt-dix, les bailleurs internationaux qui soutenaient le secteur ont mis l’accent sur sa pérennité financière. Ils ont alors enjoint les IMF de récupérer leurs coûts, mais aussi de dégager des bénéfices afin de s’émanciper des subventions et d’attirer des fonds privés. On a ainsi vu un nombre croissant d’ONG de microfinance se transformer en Sociétés Anonymes ou même en Banques ; dans le même temps, les coopératives d’épargne et de crédit ont été marginalisées.
Ce modèle a été consacré en 2006 par l’attribution du Prix Nobel de la Paix à Mohamad Yunus et à la Grameen Bank, puis par plusieurs autres distinctions internationales. En termes d’image, cette aura symbolique a cependant accru le risque pesant sur la microfinance. D’autant que les critiques se sont multipliées, attisées par des pratiques abusives et les profits faramineux réalisés par certaines IMF. Dans plusieurs pays d’Amérique latine – comme la Bolivie, l’Équateur ou le Nicaragua –, les nouveaux gouvernements socialistes ont par exemple adopté des postures particulièrement hostiles à la microfinance, cherchant à les nationaliser ou bien à les remplacer par de nouvelles banques publiques.
Cadrage théorique
1. Normes et régulation de la microfinance. En revendiquant des fonctions de développement, tout en demeurant régie par des mécanismes marchands, la microfinance brouille les frontières entre le social et le commercial, le public et le privé. De plus, bien qu’elles aient été promues par des acteurs transnationaux, telles que des ONG, des agences de développement et des investisseurs, les pratiques micro-financières relèvent intrinsèquement du local. Comme toute activité financière de détail, elles sont le plus souvent gérées et étroitement règlementées au plan national. Ces hybridités favorisent un mode de gouvernance de la microfinance fondé sur des normes dont les référentiels ont généralement été forgés dans des forums internationaux.
2. Privatisation des politiques publiques de développement. Durant les trois dernières décennies, les stratégies des acteurs du développement ont été marquées par le paradigme néolibéral. Dans ce contexte, les États ont été incités par les IFI à limiter leurs politiques agricoles ou de financement à un rôle de facilitateur, afin de renforcer des marchés ouverts, peu régulés et compétitifs. En matière d’instruments, l’intervention directe des administrations publiques a été jugée inefficiente et a été minimisée au profit d’opérateurs privés tels que les ONG ou les entreprises commerciales.
Analyse
La crise financière et les récentes crises alimentaires remettent en cause le paradigme actuel du développement. En matière agricole, les tensions ne dérivent pas tant d’un manque de production mondiale que d’une répartition inégalitaire de la valeur ajoutée. À cet égard, soulignons combien la libéralisation commerciale met aujourd’hui en concurrence directe l’agro-industrie avec des sociétés paysannes sous capitalisées (41% de la population du globe). Dans ces conditions, les prix internationaux sont fixés au niveau de rentabilité des 15% des producteurs affichant les meilleurs rendements. Mais cette asymétrie entraîne une paupérisation des populations rurales qui représentent au plan mondial 75% des malnutris. Autrement dit, à l’heure ou la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture), le FIDA (Fonds international de développement agricole), et même la Banque Mondiale, remettent le secteur agricole au cœur des priorités du développement, la controverse s’accentue entre les tenants d’un approfondissement du modèle agro-industriel et les partisans d’une revalorisation des agricultures familiales. Or, les gouvernements socialistes latino-américains, arrivés au pouvoir avec l’appui de mouvements populaires paysans, tendent à favoriser cette seconde alternative. Par ailleurs, la microfinance peine à desservir les petits agriculteurs exposés à des aléas importants. En effet, ces derniers ne disposent généralement d’aucune garantie car ils ne bénéficient pas de revenus réguliers et suffisamment substantiels pour supporter les taux d’intérêts structurellement élevés des IMF. Pour toutes ces raisons, la microfinance s’est souvent concentrée sur les milieux urbains, finançant plus particulièrement les micro-activités de commerce et de services pratiqués par les déplacés de l’exode rural. Cet échec du marché à assurer le développement rural remet néanmoins en cause l’image souvent médiatisée de la microfinance. En outre, il alimente le discours des gouvernements socialistes qui menacent régulièrement de prendre le contrôle des IMF ou de les obliger à réduire de manière drastique leurs taux d’intérêts.
Pour leur part, les IMF renforcent des associations corporatives qui obéissent à des stratégies diverses. Les plus commerciales s’attachent, par exemple, à sécuriser leur reconnaissance juridique et à obtenir des appuis auprès d’institutions internationales ou d’acteurs économiques déterminants. Quant aux organisations plus sociales et rurales regroupées dans le cadre du FOROLAC, elles souhaitent accroître leur légitimité en se rapprochant des organisations paysannes. Pour ce faire, elles développent des programmes ruraux ou agricoles et cherchent à établir des alliances avec les banques publiques de développement. À ce titre, ce séminaire organisé au Brésil par le FOROLAC revêt une importance certaine. En effet, comme les relations apparaissent souvent tendues entre IMF et gouvernements, il s’agit, en l’occurrence, de parvenir à un rapprochement avec le gouvernement de Lula afin de créer un précédent et de proposer un modèle de référence.
Références
Guérin Isabelle, Lapenu Cécile, Doligez François (Éds.), La Microfinance est-elle socialement responsable ?, Revue Tiers-Monde, (197), Janv.-mars 2009.
Mazoyer Marcel, Roudart Laurence, La Fracture agricole et alimentaire mondiale : nourrir l’humanité aujourd’hui et demain, Paris, Éditions Universalis, 2006.
Trivelli Carolina, Venero Hildegardi, Banca de desarrollo para el agro: experiencias en curso en América Latina, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2007.