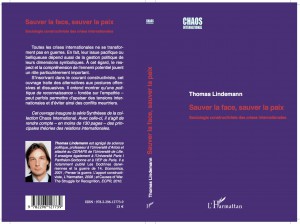Nov 12, 2010 | Droit international public, Droits de l'homme, Justice internationale, Passage au crible
Par Yves Poirmeur
Passage au crible n°29

Source : Pixabay
Le 11 octobre 2010, les autorités françaises ont arrêté Callixte Mbarushimana, secrétaire exécutif des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda-Forces combattantes Abacunguzi, visé par un mandat d’arrêt de la CPI (Cour Pénale Internationale) pour des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité qu’il est présumé avoir commis, en 2009, dans les provinces du Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo. Cette arrestation d’un ressortissant rwandais résidant en France depuis 2002, avec le statut de réfugié politique, illustre les avancées de la lutte contre l’impunité rendue possible par la création de la CPI dont la France a été l’un des premiers pays européens à ratifier le statut de Rome (9 juin 2000). Elle a pu procéder à cette arrestation parce qu’à la différence d’États moins collaboratifs, elle avait adapté dès 2002 (loi du 26 février 2002) sa procédure pénale pour répondre aux demandes d’enquête et d’arrestation de suspects émanant de la CPI. Toutefois la législation française laisse encore une place substantielle à l’impunité. En effet, la récente loi du 10 août 2010 qui parachève « l’adaptation droit pénal à l’institution de la CPI » procède à une harmonisation très restrictive du droit pénal interne avec la définition des incriminations retenue par le statut de Rome. En outre, elle retient une conception trop étroite de la compétence universelle. Ceci permet en conséquence à certains criminels internationaux présents sur son territoire français d’échapper aux poursuites.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
La répression internationale des crimes internationaux s’est difficilement institutionnalisée, au cours du XXe siècle, dans une société internationale constituée d’États souverains voyant tout engagement international de la responsabilité pénale de leurs dirigeants et de leurs soldats comme une atteinte inacceptable à leur souveraineté. Apparue une première fois sous la forme des tribunaux ad hoc de Nuremberg (1945) et de Tokyo (1946), la justice pénale internationale a connu ensuite une longue éclipse liée au conflit est/ouest. Puis, elle a pris la forme de juridictions spéciales créées par le Conseil de sécurité de l’ONU pour juger les responsables des violations du droit international humanitaire en Yougoslavie –TPIY (1993)- et du génocide au Rwanda –TPIR (1994). Finalement, elle a été dotée d’une juridiction permanente par la Convention de Rome (1998) instituant la CPI avec pour mission de poursuivre et sanctionner les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le génocide, et le crime d’agression dont la définition n’est pas encore donnée. Les enquêtes ouvertes par cette juridiction très récente sont, pour l’instant, encore peu nombreuses, tout comme les mandats d’arrêts et les citations à comparaître qu’elle a délivrés. Ses investigations concernent la République centrafricaine, le Darfour, l’Ouganda, le Kenya et la République démocratique du Congo, alors que bien d’autres situations justifieraient certainement des enquêtes comme en Côte d’Ivoire, en Guinée, Colombie et Palestine.
Dans la lutte contre l’impunité, la justice pénale internationale se heurte à deux obstacles principaux. Le plus évident résulte de ce que seuls 113 États ont, pour l’heure, ratifié le statut de Rome, ce qui permet aux criminels internationaux de trouver refuge sur le territoire des pays qu’il ne lie pas. Le second obstacle réside dans le souci des États de conserver leur indépendance en faisant notamment prévaloir leur conception du droit pénal et en assurant l’impunité de certains crimes dans lesquels ils pourraient être éventuellement impliqués. Il tient aussi au défaut d’harmonisation des incriminations du droit pénal des États parties avec celles du droit pénal international et à l’inadaptation de leurs procédures pénales pour répondre aux demandes d’enquête et d’arrestation de la CPI. Enfin, il est également dû aux définitions trop restrictives de leur compétence universelle qui laissent subsister d’importantes failles juridiques permettant à toute personne suspectée d’un crime international d’une gravité extrême de se soustraire à toute poursuite, tant devant les juridictions nationales que devant la CPI.
Cadrage théorique
1. Le principe de complémentarité. L’architecture de la justice pénale internationale retenue par le statut de Rome (art. 1) repose sur un principe de complémentarité donnant aux juridictions nationales compétence prioritaire pour juger les crimes internationaux. Ce n’est qu’à titre subsidiaire – dans l’hypothèse où les États sont défaillants et n’exercent aucune poursuite – que la CPI est compétente pour connaître limitativement « des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble » (art. 5).
2. La compétence universelle. L’opérationnalisation du statut de Rome exige que les États parties exercent pleinement la compétence universelle qui leur est internationalement reconnue pour réprimer des infractions commises par des personnes à l’étranger, alors que ni leur auteur, ni leurs victimes ne sont ses ressortissants. Pour pouvoir le faire légitimement – sans encourir le reproche de s’ingérer dans les affaires d’un autre État ou d’instrumentaliser la justice à des fins politiques – il convient que la définition de ces infractions par le droit pénal interne soit conforme à celle du droit international et accessoirement que l’ensemble de la procédure judiciaire – enquêtes, instruction, procès – respecte les principes du droit à un procès équitable en offrant des garanties similaires à celles de la CPI.
Analyse
Lorsque la CPI prend l’initiative des enquêtes et des poursuites, le code de procédure pénale (art.627-4 à 627-15) permet à la France de collaborer efficacement avec elle et d’assurer l’impunité. En revanche, la loi du 10 août 2010 soumet la mise en œuvre de la compétence universelle pour les crimes relevant du statut de Rome à des exigences si lourdes que son exercice par les juridictions françaises risque d’être tout à fait exceptionnel, permettant ainsi à des criminels internationaux de se glisser entre les mailles du filet répressif. En effet, cette compétence extraterritoriale des juridictions est subordonnée à quatre conditions cumulatives : 1) la résidence habituelle de l’auteur présumé des faits sur le territoire de la République ; 2) l’incrimination de ces faits par la législation pénale de l’État où ils ont été commis ou, à défaut, la ratification par cet État ou par celui dont la personne concernée à la nationalité de la convention de Rome ; 3) la poursuite de ces crimes ne peut intervenir qu’à la requête du ministère public ; enfin 4), aucune juridiction internationale ou nationale ne doit avoir demandé la remise ou l’extradition de l’auteur des faits, ce dont le ministère public doit s’assurer en vérifiant notamment que la CPI «décline expressément sa compétence » (code de procédure pénale, art. 689-11). Le critère de la résidence habituelle plutôt que celui d’une simple présence de l’auteur présumé de crimes graves sur le territoire national, épargnera à la France – au grand dam des associations de défense des droits de l’homme – d’avoir à juger les nombreux auteurs présumés de crimes internationaux de passage sur son sol, qui peuvent sans grands risques continuer à rendre de simples visites. Quant au principe de complémentarité consacré par le statut de Rome et donnant la priorité des poursuites aux juridictions nationales, il paraît comme inversé par la subordination de leur engagement à la condition que la CPI décline préalablement sa compétence. C’est ainsi une conception résiduelle de la compétence universelle pour les crimes les plus graves qu’a consacrée le législateur au prétexte d’éviter une improbable concurrence entre juridictions. La loi de 2010 a par ailleurs adapté le code pénal aux définitions des crimes prévus par le statut de la CPI, en y insérant un nouveau livre dédié à la répression des crimes de guerre incluant de nouvelles incriminations – viols, meurtres… –, en complétant la liste des faits constitutifs de crimes contre l’humanité – atteintes volontaires à la vie, atteintes à la liberté ou de violences aux personnes sous toutes leurs formes dans le cadre d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile – et en précisant les responsabilités des auteurs de génocides, l’incitation publique et directe à commettre un génocide étant désormais sanctionnée. Si l’arsenal répressif est aujourd’hui heureusement renforcé et d’importantes lacunes comblées, l’harmonisation demeure loin d’être achevée. Il suffit pour s’en convaincre, d’observer que le délai de prescription des crimes de guerre fixé par le code pénal est de 30 ans, alors que le statut de Rome retient l’imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la Cour (art. 29). C’est moins par les lacunes de sa transposition des infractions internationales en droit interne que par sa conception étriquée de la compétence universelle, lui évitant complications politiques et désagréments diplomatiques, que la France limite sa contribution directe à la lutte contre l’impunité, en engageant elle-même les poursuites. En revanche, elle y participe efficacement et sans risque en coopérant pleinement avec la CPI. C’est ainsi que le 3 novembre 2010, la Cour d’appel de Paris a ordonné la remise de M. Mbarushimana à la Cour de La Haye.
Références
Bussy Florence, PoirmeuYvesr, La Justice politique en mutation, Paris, LGDJ, 2010.
Philippe Xavier, Desmarest Anne, « Le projet de loi portant adaptation du droit pénal français à la Cour Pénale Internationale », Revue française de droit constitutionnel, (81), janvier 2010, pp. 41-65.
Sep 20, 2010 | Ouvrages, Publications
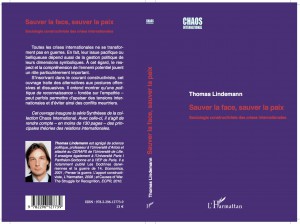
Thomas Lindemann
Toutes les crises internationales ne se transforment pas en guerres. En fait, leur issue pacifique ou belliqueuse dépend aussi de la gestion politique de leurs dimensions symboliques. À cet égard, le respect et la compréhension de l’ennemi potentiel jouent un rôle particulièrement important.
S’inscrivant dans le courant constructiviste, cet ouvrage traite des alternatives aux postures offensives et dissuasives. Il entend montrer qu’une politique de reconnaissance – fondée sur l’empathie – peut parfois permettre d’apaiser des tensions internationales et d’éviter ainsi des conflits meurtriers.
Cet ouvrage inaugure la série Synthèses de la collection Chaos International. Avec celle-ci, il s’agit de rendre compte – en moins de 130 pages – des principales théories des relations internationales.
Thomas Lindemann est agrégé de science politique, professeur à l’Université d’Artois et attaché au CERAPS de l’Université de Lille. Il enseigne également à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l’IEP de Paris. Il a notamment publié Les Doctrines darwiniennes et la guerre de 14, Economica, 2001 ; Penser la guerre. L’apport constructiviste, L’Harmattan, 2008 ; et Causes of War. The Struggle for Recognition, ECPR, 2010.
Commander l’ouvrage
Sep 15, 2010 | Diffusion de la recherche, Séminaires
En partenariat avec l’École doctorale du Département de science politique de l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, Chaos International a organisé un séminaire de recherche en langue anglaise le mercredi 15 septembre autour de John Cash.
Professeur de philosophie et d’anthropologie sociale à l’Université de Melbourne, ce dernier a délivré une communication intitulée Passionate Attachments, Conflicted Relations qui partait de L’Homme aux rats de Sigmund Freud pour en venir à une lecture critique des travaux d’Alexander Wendt et à une réflexion plus globale sur l’état actuel de la scène mondiale.
Téléchargements
L’article du professeur John D. Cash
L’échange des questions réponses
Juil 22, 2010 | Biens Publics Mondiaux, Environnement, Passage au crible
Par Clément Paule
Passage au crible n°28

Source : Pixabay
Le 15 juillet 2010, les ingénieurs de la compagnie pétrolière BP (ex-British Petroleum) seraient parvenus à contenir la fuite du puits Macondo à 1500 mètres de profondeur. Trois mois après l’explosion et le naufrage de la plate-forme Deepwater Horizon, le déversement d’hydrocarbures dans le Golfe du Mexique semble temporairement endigué. D’après les estimations de l’AIE (Agence Internationale de l’Énergie), entre 2,3 et 4,5 millions de barils de pétrole – entre 365 et 715 millions de litres – se seraient écoulés après l’accident. Par ailleurs, BP – qui exploite la structure offshore et gère la crise post-accidentelle aux côtés des autorités américaines – a déjà déboursé près de 4 milliards de dollars pour lutter contre la catastrophe. Toutefois, la facture finale pourrait s’élever à 37 milliards selon les projections du Credit Suisse Group. Outre ce défi financier, le groupe énergétique a surtout fait l’objet de nombreuses critiques portant sur son incapacité à maîtriser rapidement le désastre.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Créée au début du XXe siècle en Iran, l’APOC (Anglo-Persian Oil Company) s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs d’une industrie naissante. Cependant, l’entreprise – rebaptisée BP en 1954 – est confrontée dans les années soixante aux nationalisations opérées par les gouvernements du Moyen-Orient. Dès lors, la firme se transnationalise pour exploiter de nouveaux gisements, en particulier dans l’Alaska et dans la Mer du Nord. Vingt ans plus tard, elle reste présente dans plus de cent pays et emploie plus de 100 000 personnes. À ce titre, elle fait partie des six supermajors pétrolières avec Exxon Mobil, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips et Total. Apparus à la fin des années quatre-vingt-dix, ces conglomérats sont issus d’un mouvement de concentration du secteur, consécutif à la volatilité des prix. C’est dans ce cadre que BP a investi massivement le marché américain en rachetant successivement les sociétés Sohio (Standard Oil of Ohio) en 1987, puis Amoco (ex-Standard Oil of Indiana) et Arco (Atlantic Richfield Company) entre 1998 et 2000. En l’espèce, cette implantation s’inscrit dans une stratégie fondée sur l’innovation et décidée par Lord Browne, chief executive entre 1995 et 2007. Le géant énergétique s’est alors distingué par ses multiples prises de risques : citons par exemple la série d’accords ambitieux signés en Russie ou bien encore la promotion des énergies alternatives.
Dans cette logique, le développement du forage offshore reste au centre des préoccupations de la supermajor alors que les gisements plus accessibles sont désormais contrôlés par des sociétés nationales. En l’occurrence, un cinquième des réserves mondiales de pétrole se trouveraient dans les fonds marins. Pionnier de cette technique d’extraction, BP demeure le premier producteur d’hydrocarbures dans le Golfe du Mexique. Cette orientation a été soutenue par les États-Unis dont les gouvernements successifs – y compris l’administration Obama – ont allégé les restrictions sur le forage domestique. À cet égard, la puissance américaine s’est efforcée de limiter sa dépendance énergétique, en particulier face à l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole). Le groupe a pu s’appuyer sur la découverte de gisements comme Tiber – dont la seule annonce a fait grimper de 4% le titre de l’entreprise en 2009 – pour ouvrir une nouvelle ère énergétique. Cependant, notons que cette technique a pu provoquer des accidents ayant conduit à des marées noires dans le Golfe du Mexique. En témoigne la destruction en 1979 du puits Ixtoc I géré par la compagnie d’État mexicaine Pemex (Petróleos Mexicanos). Plus généralement, les installations de BP aux États-Unis n’ont pas été épargnées par ces aléas. Citons en 2006 la fuite de Prudhoe Bay en Alaska, d’autant qu’une raffinerie située au Texas avait explosé l’année précédente, éveillant l’attention des autorités et de l’opinion publique américaines.
Cadrage théorique
1. Stigmatisation d’un acteur déviant. Inspirés de l’interactionnisme symbolique d’Howard Becker, certaines notions permettent de rendre compte de la délégitimation rencontrée par le groupe pétrolier après l’accident. Concentrant les critiques, BP fait l’objet d’un travail ambivalent de stigmatisation aussi bien de la part de ses pairs que de l’administration Obama.
2. Réputation et image d’une firme transnationale. Il s’agit ici d’évoquer l’intrication entre la perception de la supermajor et ses performances économiques. À l’inverse des États qui souffriraient peu – selon Jonathan Mercer – du facteur réputationnel, les opérateurs privés ne disposent pas d’une légitimité objectivée. Ils seraient donc plus sensibles que les acteurs étatiques aux variations de leur image pouvant mettre en jeu leur survie.
Analyse
En premier lieu, il convient de rappeler les déconvenues de BP face au sinistre. Mentionnons les revers subis par ses experts sur le plan technique, avec des solutions inefficaces et des plans d’urgence dépassés. Ainsi, la procédure du top kill a échoué peu après son déclenchement le 26 mai, les routines organisationnelles du groupe paraissant alors inopérantes. Ces difficultés pratiques se sont conjuguées aux déboires d’une communication peu maîtrisée. Tony Hayward, CEO (Chief Executive Officer) de BP a notamment provoqué plusieurs scandales en minimisant l’impact environnemental de l’accident. En fait, la compagnie n’est pas parvenue à mettre en place une technologie de crise socialement acceptable. Ce qui entre en dissonance avec une image entrepreneuriale construite fondamentalement sur l’expertise et la supériorité technique. Or, cet échec symbolique produit un impact économique et financier, compte tenu de l’effondrement de la valeur boursière de la firme. En effet, celle-ci s’élevait à environ 170 milliards de dollars en avril 2010, selon le classement Forbes Global 2000 où BP occupait alors le dixième rang. Fin juin, ce résultat aurait été divisé par deux, et l’agence internationale de notation Fitch Ratings a alors rétrogradé le géant énergétique, anticipant l’accumulation imminente des coûts.
D’autre part, l’incapacité de BP à tenir un discours d’autorité sur la gestion de la crise suscite le développement de controverses sociotechniques caractérisées par une forte incertitude. Citons l’escalade des estimations du volume de la fuite, initialement de 1000 barils par jour pour atteindre aujourd’hui le chiffre de 60 000. Outre cette considération, la compétence de la compagnie pétrolière est décriée aussi bien par ses concurrentes que par le gouvernement américain. Ces derniers intervenants sont impliqués à des degrés divers dans la gestion du sinistre et subissent les conséquences des échecs successifs. En l’espèce, les valeurs boursières d’Exxon Mobil ou de Total ont chuté de 15% en raison du discrédit de BP. D’où des tactiques de stigmatisation et de démarcation pour souligner les défaillances d’une firme présentée comme aventureuse et négligente des risques. Mentionnons en ce sens l’audition du 15 juin, devant le Congrès américain, des responsables de ConocoPhillips ou de Royal Dutch Shell qui ont décrit un incident isolé, imputable aux seules erreurs de BP. Quant aux autorités américaines, elles ont adopté une posture d’entrepreneur de morale, la marée noire pouvant devenir un test politique 5 ans après Katrina.
Enfin, l’administration de la catastrophe paraît mettre en jeu la survie même de la compagnie. Rappelons que la chute brutale de sa valeur boursière place BP sous la menace d’une OPA (Offre Publique d’Achat) hostile, voire d’une faillite. Le groupe peut certes s’appuyer sur ses ressources consolidées en 2009 avec 17 milliards de dollars de bénéfice net. Mais il s’avère aussi contraint à des stratégies d’extraversion, sollicitant Goldman Sachs pour le conseiller financièrement ou des fonds souverains – qataris ou libyens – en vue d’une association stratégique. Toutefois, l’impact de sa position déviante demeure limité dans la mesure où les autres supermajors entendent éviter une OPA décrite par le CEO de Total comme une opération non éthique. Cette position ambivalente pourrait s’expliquer par la crainte de bouleverser un ordre économique encore instable. Elle semble plus encore relever d’une réaction commune contre toute tentative externe de régulation, à commencer par le moratoire de l’administration Obama sur le forage offshore. Ce qui pose à nouveau la question de règles – pragmatiques ou normatives – susceptibles de définir et de sanctionner la déviance des acteurs privés au plan mondial.
Références
Becker Howard, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, [1963], trad., Métailié, Paris, 1985.
Crooks Ed, « BP – Anatomy of a Disaster – Part 1; Cover Story », The Financial Times, 3 juillet 2010.
Dobry Michel, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, 3e éd., Paris, Presses de la FNSP, 2009.
Mercer Jonathan, Reputation in International Politics, Ithaca, Cornell University Press, 1996.
Juil 20, 2010 | Ouvrages, Publications

Sous la direction de Josepha Laroche
La crise de la finance mondiale de 2008, a conduit à la faillite un grand nombre de banques, affaibli des entreprises et appauvri des États, tandis qu’elle a mis au défi des organisations internationales comme le FMI ou l’OMC. Aujourd’hui, elle continue de faire des ravages dans toutes les sociétés en frappant des millions de personnes dans leur vie quotidienne et leur emploi. Elle les précarise et les paupérise, les privant de toutes perspectives d’avenir.
Comment une telle violence économique a-t-elle été possible et quels sont les mécanismes structurels qu’il convient d’appréhender pour comprendre une spirale aussi destructrice ? Chaos International s’est efforcé d’analyser cet engrenage en réunissant une équipe internationale de chercheurs en sciences sociales – politistes, économistes et sociologues – qui proposent des lectures complémentaires de cet état du monde.
Ont contribué à cet ouvrage
André Cartapanis, Philip G. Cerny, Daniel Drache, Thomas Lindemann, Ronen Palan, Franck Petiteville, Marc Raffinot, Michel Rainelli, Jean-Jacques Roche, Philippe Ryfman, Saskia Sassen, Catherine Wihtol de Wenden.
Commander l’ouvrage