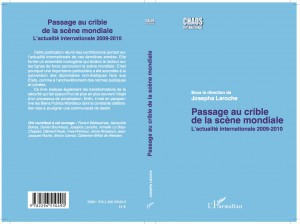Mai 27, 2011 | Chine, Droits de l'homme, Paix, Passage au crible
Par Anaïs Henry
Passage au crible n°42

Source : Pixabay
Le 10 mars 2011, le quatorzième Dalaï-Lama, Tenzin Gyatso, a décidé de céder son pouvoir politique au Premier ministre du gouvernement tibétain en exil. Ainsi, depuis le 27 avril, Lobsang Sangay assume-t-il le rôle de leader de la communauté tibétaine. Cette décision a beaucoup surpris, car depuis près de quatre siècles les Dalaï-Lamas incarnaient un pouvoir tout à la fois politique et spirituel, particulièrement aux yeux des 150 000 Tibétains en exil à travers le monde.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Le Tibet a connu différentes périodes de diffusion du bouddhisme depuis le VIIIe siècle. Cependant, ce n’est qu’au XVIe siècle que Sonam Gyatso, troisième abbé du monastère guélougpa de Drépung, a été reconnu pour la première fois comme Dalaï-Lama. Rétrospectivement, ses deux prédécesseurs sont devenus premier et deuxième Dalaï-Lama ; tous représentant dès lors le système des réincarnations. Initialement, ils détenaient juste le pouvoir religieux et se trouvaient ainsi garants des quatre branches du bouddhisme tibétain, à savoir celles des Nigmapas, des Kagyupas, des Sakyapas et des Guélougpas. Mais en 1642, « grâce au soutien des Mongols, le cinquième Dalaï-Lama unifie, […], un vaste territoire sous l’autorité d’un gouvernement ecclesiastico-nobiliaire, à Lhassa, le Ganden phodrang ». Á partir de ce moment, les Dalaï-Lamas vont exercer au Tibet un pouvoir aussi bien religieux que politique.
En 1949, Mao Zedong, qui vient de former la RPC (République Populaire de Chine), ordonne d’envahir le Tibet. En 1950, Tenzin Gyatso – alors âgé seulement de 15 ans – est intronisé comme Dalaï-Lama. Malgré ses efforts de négociation avec le gouvernement chinois, il est contraint de s’exiler en Inde, le 10 mars 1959. Depuis cette date, nombre de Tibétains se sont également réfugiés à l’étranger. Une majorité d’entre eux s’est installée dans les pays frontaliers (Inde, Népal, Sikkim, Ladakh), mais aussi en Europe et dans les pays anglo-saxons. Dès ces premières années, le Dalaï-Lama a jeté les bases d’un gouvernement visant à sauvegarder son peuple et sa culture. Grâce à la constitution qu’il a établie, un gouvernement en exil a été constitué, à Dharamsala, dans un esprit démocratique et respectueux des droits de l’Homme.
Le Dalaï-Lama a reçu plusieurs récompenses pour son combat en faveur de la non-violence, des droits humains et de la paix. Rappelons à cet égard que le Prix Nobel de la paix lui a été décerné le 10 décembre 1989. Plus récemment, le Congrès américain lui a remis sa médaille d’or en octobre 2007, pour saluer son engagement en faveur de la non-violence.
Cadrage théorique
Retenons deux lignes de force :
1. L’accomplissement d’un processus de démocratisation. La décision du Dalaï-Lama illustre la thèse de Laurence Whitehead. Selon ce dernier, nous assisterions depuis la fin du monde bipolaire à une normalisation du processus de démocratisation sur la scène internationale qui passerait par l’élection libre des dirigeants politiques.
2. Les jeux croisés de qualification. Soulignons la stratégie de mise au ban développée par la Chine sur la scène mondiale et visant le Prix Nobel tibétain.
Analyse
Depuis son intronisation, le quatorzième Dalaï-Lama a souhaité un changement démocratique. Dans cette perspective, avant même de partir en exil, il a modifié le système judiciaire et fait lever la dette héréditaire qui soumettait les paysans à l’aristocratie. Après son départ pour l’étranger, il a mis en place nombre d’institutions garantes de l’identité tibétaine et il a facilité l’émergence d’un système démocratique. Dans les années 1980-1990, il a impulsé la création de bureaux dans des pays où se trouvaient implantées d’importantes communautés tibétaines. C’est ainsi que ces dernières peuvent à présent voter pour leurs représentants. Ainsi, en confiant le pouvoir exécutif au Premier ministre, le Dalaï-Lama finalise-t-il un processus de démocratisation déjà en cours. Plus récemment, les populations du monde arabe se sont soulevées contre leurs dirigeants pour réclamer la démocratie. Mais ici, nous sommes en l’occurrence dans une autre configuration car ce ne sont pas les Tibétains qui ont demandé à leur leader de quitter le pouvoir, bien au contraire. Cela ne résulte pas davantage d’une directive extérieure. Il est en revanche question de la politique paternaliste et charismatique d’un homme âgé de soixante-quinze ans qui a estimé venu le temps de l’autogouvernement de son peuple.
Outre cette considération, il faut également comprendre que le Dalaï-Lama fait l’objet d’une politique de disqualification de la part des autorités chinoises. En effet, lorsqu’il accomplit une action ou se trouve en déplacement, les autorités chinoises le dénigrent. Pour eux, il s’agit d’un moine en robe de bure, d’un séparatiste, d’un despote, cherchant à maintenir ses sujets dans l’asservissement. Mao Zedong avait d’ailleurs légitimé, a posteriori, l’invasion du Tibet, en invoquant la nécessité de le libérer d’un régime théocratique. Au cœur de cette opération s’inscrit toutefois une manipulation de l’information, l’objectif recherché étant la captation d’une légitimité internationale. Cependant, aujourd’hui, le responsable politique du gouvernement tibétain en exil est désormais un laïc élu au suffrage universel par la majorité des Tibétains en exil (55%). De ce fait, le gouvernement chinois ne pourra plus utiliser à l’avenir ce répertoire de stigmatisation envers ce nouveau dirigeant. Enfin, la Chine, mais aussi d’autres pays, ont dénoncé auparavant le statut du Dalaï-Lama qui mêlait le religieux au politique. Or, le changement accompli récemment dans la dévolution du pouvoir exécutif réduit à néant cette critique.
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un combat politique qui dure depuis plus de soixante ans. Par la non-violence, le peuple tibétain montre combien il aspire à une amélioration des droits de l’Homme en Chine et au respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Références
Heath John, Tibet and China in the Twenty-first Century, Londres, Saqi, 2005.
Stil-Rever Sofia, Le Dalaï-Lama. Appel au monde, Paris, Seuil, 2011.
Travers Alice, « Chronologie de l’histoire du Tibet », Outre-Terre, (21), janv. 2009, pp. 109-128.
Withehead Laurence, « Entreprise de démocratisation : le rôle des acteurs externes », Critique internationale, Presse de Sciences Po, (24), mars 2004, pp. 109-124.
Mai 23, 2011 | Droits de l'homme, Passage au crible, Union européenne
Par Franck Petiteville
Passage au crible n°41

Source Pixabay
Face à la crise libyenne du printemps 2011, l’Union européenne (UE) a progressivement pris le parti des insurgés de Benghazi, demandé le départ du colonel Kadhafi, adopté des sanctions contre son régime le 11 mars 2011 et proposé une opération militaire européenne à vocation humanitaire le 1er avril.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
La vocation de l’UE à gérer les crises internationales est aussi ancienne que la première expérience de diplomatie commune via la Coopération politique européenne des années soixante-dix. Le traité de Maastricht (1992) a élevé les ambitions de l’UE dans la gestion des crises, en créant la PESC (Politique Étrangère et de Sécurité Commune), demeurée toutefois impuissante dans les conflits de l’ex-Yougoslavie (250 000 morts). Le lancement de la politique européenne de défense en 1999 a progressivement doté l’UE d’instruments militaires de gestion de crise, qui ont notamment été utilisés en Afrique dans les années deux mille (interventions en République Démocratique du Congo en 2003, au Tchad en 2008, au large des côtes somaliennes en 2008-9).
De son côté, l’implication de l’UE en Méditerranée est également ancienne. Elle a connu différents cadres ces quinze dernières années : processus de Barcelone (1995), reposant sur un ensemble d’accords de coopération économique et d’aide au développement, politique de voisinage (2004) puis Union pour la Méditerranée lancée en 2008.
L’UE a toutefois été prise de court par le printemps arabe. Réagissant tout d’abord en ordre dispersé, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont cherché à afficher une position commune lors du Conseil européen extraordinaire du 11 mars 2011. Ils ont affirmé leur soutien aux révolutions arabes et notamment aux annonces de transition démocratique en Égypte et en Tunisie. S’agissant de la Libye, ils ont à l’inverse condamné la répression, déclaré le colonel Kadhafi « illégitime », et reconnu le « Conseil national de transition » établi par les insurgés de Benghazi comme « interlocuteur politique ». En appui aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, l’UE a également adopté diverses sanctions contre le régime de Kadhafi (embargo sur les armes, interdiction de visa, gel des avoirs, etc.). Elle a notamment manifesté l’intention d’empêcher le régime d’engranger les dividendes des exportations de pétrole et de gaz. Le 1er avril, l’UE a franchi une nouvelle étape en jetant les bases d’Eufor Libye, une opération militaire relevant de la PESC, visant à sécuriser l’aide humanitaire aux personnes déplacées par le conflit, et susceptible d’être déclenchée sur demande du Bureau pour la coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies.
Cadrage théorique
Retenons deux lignes de force :
1. La crise libyenne comme mise à l’épreuve de la cohésion des Vingt-Sept
Dans une perspective de théorie réaliste des relations internationales, la notion de politique étrangère européenne apparaît impropre. En effet, seuls les Etats possèdent les attributs de la politique étrangère : souveraineté, intérêt national, puissance militaire. Dans cette perspective, les Etats membres de l’UE seront toujours réticents à céder de leur souveraineté en matière de high politics, comme ils le font dans le domaine économique. Les réalistes ne sont donc en général guère surpris que, lors des grandes crises internationales, les Etats membres de l’UE réagissent en ordre dispersé et expriment tout d’abord leur intérêt national, comme lors de la division européenne de 2003 sur la guerre en Irak. À son tour, la crise libyenne peut donner le sentiment de conforter cette vision car les Européens n’ont pas affiché une position commune très forte ni très visible. Au contraire, les diplomaties nationales se sont une fois de plus singularisées. La France de Nicolas Sarkozy et le Royaume-Uni de David Cameron ont ainsi précocement imposé l’idée d’une intervention armée extérieure. Quant à l’Allemagne d’Angela Merkel, elle a au contraire refusé tout risque d’engrenage de guerre, et s’est abstenue lors du vote de la résolution 1973 du 17 mars 2011 sur la zone d’exclusion aérienne au Conseil de sécurité. De son côté, l’Italie de Berlusconi n’a cessé de tergiverser, depuis la réaffirmation de l’amitié italo-libyenne au début de la crise jusqu’à la conversion contrainte aux opérations armées de la coalition fin avril 2011.
2. Un test de crédibilité de la politique étrangère européenne après Lisbonne
Beaucoup d’attentes ont été placées ces dernières années à la fois dans les nouvelles potentialités de la politique européenne de défense commune et dans les nouveaux leviers de la politique étrangère européenne créés par le traité de Lisbonne : président du Conseil européen, poste de haut représentant pour les Affaires étrangères et de sécurité, Service européen d’action extérieure. Pour autant, il n’est pas sûr que la gestion de la crise libyenne par l’UE ait répondu à ces attentes. En effet, sur le plan militaire, c’est l’OTAN et non l’UE qui a pris en charge l’opération de bombardement des forces du colonel Kadhafi ; la politique européenne de défense n’étant mobilisée qu’aux marges du conflit, pour éventuellement mettre en œuvre une opération à vocation humanitaire. Sur le plan diplomatique, Herman Van Rompuy et Catherine Ashton ont fait ce qu’ils ont pu pour relayer les positions européennes sur la scène internationale, mais leur visibilité est demeurée limitée par le minimalisme de l’entente entre les Vingt-Sept. Il se pourrait donc que la crise libyenne ait une fois encore révélé le capabilities expectations gap entretenu par les traités européens et par le discours officiel de l’UE. Autrement dit, le fossé perdure entre les attentes suscitées par l’UE auprès des opinions publiques et ses réalisations effectives dans l’ordre international.
Analyse
Les révolutions arabes en général, et la crise libyenne en particulier, ont une fois de plus éprouvé les limites de la politique étrangère européenne. Les Européens ont mis du temps à réagir positivement aux revendications démocratiques des peuples arabes, et à afficher une position claire en faveur du départ des dictateurs, comme Obama l’a fait rapidement à propos de Ben Ali et de Moubarak. Sur le fond, ces révolutions en chaîne ont vidé de leur consistance les politiques de coopération promues de longue date par l’UE en faveur de la Méditerranée. Jamais la démocratisation de la région n’est apparue comme un enjeu central de cette politique (les clauses de conditionnalité démocratique insérées dans les accords euro-méditerranéens n’ont d’ailleurs jamais été activées). En revanche, la crainte européenne de l’immigration en provenance du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne s’est révélée être l’enjeu structurant de la politique européenne depuis toujours. C’est plus que jamais le cas au lendemain des révolutions arabes et de la crise libyenne.
Face à la perspective d’une intervention armée en Libye pour donner corps à la fameuse « responsabilité de protéger », les Européens ne sont donc pas parvenus à un accord substantiel. Certes, l’UE a soutenu les résolutions successives du Conseil de sécurité, notamment sur les sanctions contre Kadhafi, sur la saisine de la Cour Pénale Internationale, voire sur le lancement d’une opération d’exclusion aérienne. Elle a aussi participé aux pourparlers du Groupe de contact sur l’avenir de la Libye aux côtés de la Ligue arabe et de l’Union africaine. Ce faisant, l’UE est toutefois toujours demeurée en retrait derrière le Conseil de sécurité, et relativement effacée derrière les initiatives de certains de ses États membres (France, Royaume-Uni en tête). Sur le plan militaire, l’offre européenne d’une intervention militaro-humanitaire complémentaire n’est certes pas négligeable mais – si elle voit le jour – elle ne sera jamais qu’une opération limitée et supplétive de la forte intervention militaire de l’OTAN. La gestion européenne de la crise libyenne laissera donc le souvenir d’une réaction accrochée au plus petit dénominateur commun (sanctions, opération humanitaire) entre des États membres divisés une fois encore sur la légitimité du recours à la force.
Références
Delcourt Barbara, Martinelli Marta, Klimis Emmanuel (Éds.), L’Union européenne et la gestion de crise, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 2008, 270 p.
Petiteville Franck, « Les mirages de la politique étrangère européenne après Lisbonne », Critique internationale, avril-juin 2011, pp. 94-112.
Mai 20, 2011 | Ouvrages, Publications
Sous la direction de Josepha Laroche
Cette publication réunit des contributions portant sur l’actualité internationale de ces dernières années. Elle forme un ensemble homogène qui éclaire le lecteur sur les lignes de force parcourant la scène mondiale. C’est pourquoi une importance particulière a été accordée à la subversion des diplomaties non-étatiques face aux États, comme à l’enchevêtrement des normes publiques et privées. Ce livre analyse également les transformations de la sécurité qui fait aujourd’hui de plus en plus souvent l’objet d’un processus de privatisation. Enfin, il met en perspective les Biens Publics Mondiaux dont la constante célébration vise à souligner une communauté de destin.
Ont contribué à cet ouvrage
Florent Bédécarrats, Alexandre Bohas, Daniel Bourmaud, Josepha Laroche, Armelle Le Bras- Chopard, Clément Paule, Yves Poirmeur, Jenna Rimasson, Jean- Jacques Roche, Simon Uzenat, Catherine Wihtol de Wenden.
Commander l’ouvrage
Mai 2, 2011 | Droits de l'homme, Justice internationale, Passage au crible
Par Yves Poirmeur
Passage au crible n°40

Source : Pixabay
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé dans sa résolution 1970 du 26 février 2011 de donner compétence à la CPI (Cour Pénale internationale) sur la situation en Libye. En effet, le régime du colonel Kadhafi est soupçonné d’y avoir commis des crimes contre l’Humanité à partir du 15 février 2011, en réprimant l’insurrection qui a éclatée dans l’est du pays et en conduisant des attaques systématiques et généralisées contre la population civile. Le procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, a ouvert une enquête dès le 3 mars. Puis il a annoncé, le vendredi 13 mai 2011, qu’il allait demander aux juges de délivrer des mandats d’arrêt internationaux contre « trois personnes qui semblent porter la plus grande responsabilité ». En outre, rappelons que la résolution 1970 n’ayant pas dissuadé le gouvernement libyen de poursuivre sa répression militaire, le Conseil de sécurité a autorisé une intervention militaire aérienne (Rés.1973 (2011)).
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Créée en 1998 par la Convention de Rome, la CPI représente la première juridiction pénale internationale permanente et indépendante chargée de juger les auteurs des crimes internationaux les plus graves que les États parties n’ont pas poursuivis en application de leur compétence universelle. Alors que 78 États membres de l’ONU n’ont pas ratifié son Statut et peuvent donner asile à ces criminels, l’option offerte au Conseil de sécurité de saisir cette juridiction, au titre des mesures qu’il peut prendre lorsqu’une situation menace la paix et la sécurité internationale (chapitre VII de la Charte des Nations-Unies) est un moyen complémentaire pour lutter efficacement contre l’impunité. Cette procédure a déjà été utilisée une première fois pour les crimes commis au Darfour (Résolution 1593 du 1er avril 2005). En y recourant de nouveau, le Conseil de sécurité confirme donc la légitimité de la CPI pour connaître de la situation d’États qui refusent sa compétence et la dénoncent comme un instrument de l’impérialisme occidental. En décidant très rapidement le renvoi de cette situation, il renouvelle aussi l’intérêt de ce mécanisme en en faisant un usage préventif.
Cadrage théorique
1. Une pénalisation et une judiciarisation des conflits internationaux. L’autorité de la CPI ne s’impose pas seulement aux États qui ont accepté sa juridiction en ratifiant son Statut. En effet, bien qu’elles soient par nature rares et ponctuelles, les résolutions du Conseil de sécurité lui renvoyant une situation lui confèrent, pour les cas visés, l’autorité mondiale dont elles sont revêtues. En lui déférant très tôt une situation comme il l’a fait pour la Libye, le Conseil de sécurité ne consacre par conséquent pas seulement la légitimité de la CPI comme juge pénal mondial, chargé de surveiller l’obligation faite aux États de protéger leurs populations. Il déplace en outre le conflit sur le terrain pénal et complète, ce faisant, le répertoire des mesures avec lesquelles il traite un conflit.
2. Une économie des sanctions internationales élargie à la menace pénale. Le renvoi de la situation libyenne à la CPI consacre l’idée que la menace d’une répression pénale internationale peut jouer un rôle important dans la prévention des crimes internationaux en dissuadant de passer à l’acte. La saisine de la CPI enrichit l’arsenal des mesures propres à prévenir un conflit et rétablir la paix. Elle participe d’une nouvelle économie de la menace internationale pesant sur les dirigeants politiques. Celle-ci repose sur : 1) la mise en exergue de la gravité des sanctions pénales encourues ; 2) la certitude que des poursuites seront engagées contre les auteurs de crimes ; 3) l’existence d’une juridiction compétente pour les juger. Néanmoins, si la doctrine d’emploi de cette menace est clairement établie, sa puissance dissuasive demeure en revanche très limitée.
Analyse
Adoptée à l’unanimité, alors que six des membres du Conseil de sécurité – dont trois permanents (États-Unis, Russie et Chine) – n’ont pas ratifié le statut de Rome, la résolution 1970 conforte d’autant plus la légitimité de la CPI qu’elle a reçu l’appui de la Ligue Arabe et de la Cour africaine des droits de l’Homme. Sa vocation à être saisie par le Conseil de sécurité aussitôt qu’un État n’assure plus la responsabilité de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité (Sommet mondial de 2005 (60/1)), est pleinement reconnue. Rangée symboliquement du côté des peuples contre leurs tyrans et présentée comme capable de les retenir dans leurs entreprises criminelles, la CPI est insérée dans le réseau institutionnel cohérent de protection des droits de l’Homme et de lutte contre l’impunité qui comprend notamment les ONG de défense des droits de l’Homme, le Comité des droits de l’Homme, les organisations régionales. Elle apparaît comme une composante cruciale de ce dernier et bénéficie, à ce titre, de son capital de sympathie. Globalement, le contexte des révolutions arabes s’avère propice à la diffusion d’une image de la CPI, protectrice des peuples. Il permet plus encore de disqualifier l’idée qu’elle serait un simple instrument de l’impérialisme occidental. Alors que son intervention est réclamée par les insurgés, qui dénoncent les crimes de la dictature, elle peut cependant difficilement être condamnée par les dirigeants de régimes autoritaires, qui tentent, pour se maintenir au pouvoir, des ouvertures démocratiques limitées (Maroc, Algérie).
Si l’enquête ouverte vise directement les autorités libyennes et si le procureur de la CPI a pris soin de rappeler qu’elle portera aussi sur les crimes commis éventuellement par les insurgés, la résolution 1970 a pris soin de définir strictement l’objet de sa saisine – crimes contre l’Humanité commis depuis le 14 février 2011 – et d’en exclure les ressortissants des États qui n’ont pas ratifié le statut de la Cour. Cette disposition montre combien la lutte contre l’impunité demeure toujours étroitement tributaire des intérêts des États. Certes, la légitimité de la CPI serait sans doute mieux assurée sans de telles exceptions qui l’exposent au reproche de sélectivité. Mais sans celles-ci, la situation n’aurait sans doute pas pu être déférée et la participation américaine à l’intervention militaire aérienne décidée ensuite aurait été obérée.
Alors que l’arsenal des mesures classiques n’impliquant pas le recours à la force (Charte de l’ONU, art. 21 et 41) applicables aux personnes – interdiction de voyager, gel des avoirs – affectent immédiatement leurs destinataires, pour que la justice internationale joue comme une menace et ait un rôle dissuasif, il faut conférer à l’arrestation, à la poursuite et à la condamnation des responsables de crimes internationaux une haute probabilité de réalisation. Or, même si la crédibilité de la justice pénale internationale peut se recommander des condamnations prononcées depuis la création du TPIY et des enquêtes en cours, celles-ci restent encore trop rares pour faire entrer le risque pénal dans les calculs de dictateurs aussi endurcis que M. Kadhafi, de responsables militaires et policiers spécialisés dans la répression ou de chefs de factions armées, prêts à tout pour se maintenir ou accéder au pouvoir. La poursuite de la répression a en effet confirmé que le guide et la plupart des dirigeants libyens étaient inaccessibles à cet argument. Seuls des renvois systématiques intervenant à la première alerte et la mise à disposition de moyens financiers suffisants (la résolution 1970 laisse ce financement à la charge des États partis du Statut de la CPI) pour mener les enquêtes, convertiraient ce risque en quasi-certitude et seraient peut-être susceptibles d’infléchir les activités criminelles des dirigeants les moins déterminés. La lenteur et la retenue avec laquelle le Conseil de sécurité, pour des raisons et des intérêts spécifiques à la région concernée, aborde la situation libyenne et tarde à la renvoyer à la CPI (s’il finit par le faire) contraste avec sa célérité – 10 jours seulement après le début du conflit au vu des premières informations recueillies par la Commission des droits de l’Homme – à déférer la situation libyenne. Un tel décalage confirme qu’il faudra beaucoup de temps pour que la certitude du châtiment puisse entraîner les vertus préventives qu’on prête à cette juridiction. En revanche, il apparaît probable que la stigmatisation internationale des principaux dirigeants du régime comme des criminels internationaux en puissance favorisera la désolidarisation, le retrait, voire le ralliement aux insurgés de responsables politiques et militaires moins engagés, restés jusque-là fidèles au régime. Mais au-delà de cet effet préventif incertain, une telle saisine présente d’autres mérites répressifs. Ainsi, permet-elle d’ouvrir une enquête et de recueillir immédiatement des preuves qu’il serait plus difficile ensuite de collecter et – si les éléments sont suffisants – de délivrer rapidement des mandats d’arrêts internationaux, alors même que le conflit n’est pas encore terminé. L’émission de tels ordres rendrait impossible – du moins extrêmement difficile – tout arrangement politique avec ceux qu’ils désignent, pour leur assurer ensuite l’impunité en leur trouvant une terre d’accueil.
Références
Sur le conflit : Marzouki Moncef, Dictateurs en sursis. Une voie démocratique pour le monde arabe (entretien avec Vincent Geiser), Paris, Éd. de l’atelier, 2011.
Conseil de sécurité : Résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) sur la situation en Libye.
Mai 1, 2011 | Environnement, Passage au crible, Sécurité
Par Clément Paule
Passage au crible n°39
 Source : Flickr
Source : Flickr
Selon l’édition du 3 mai du quotidien Asahi Shimbun, le gouvernement japonais aurait évalué le montant des compensations devant être versées par TEPCO (Tokyo Electric Power Company) à près de 50 milliards de dollars. Presque trois mois après le séisme du 11 mars 2011, l’accident survenu à la centrale de Fukushima-Daiichi ne semble toujours pas maîtrisé par le premier électricien asiatique. Pour autant, la question de l’indemnisation des victimes –individus et collectivités locales – suscite déjà des controverses alors que les autorités tout comme l’industrie demeurent très critiquées pour leur gestion de la crise. Ainsi, le président de la puissante organisation patronale Nippon Keidanren (Fédérations des organisations économiques japonaises), Yonekura Hiromasa, a mis en cause la responsabilité de l’État censé assurer l’intégralité des dédommagements. Pour l’heure, selon le groupe JP Morgan Chase, le coût financier de la catastrophe s’élèverait de 24 milliards de dollars pour TEPCO, tandis que la Bank of America-Merrill Lynch évoque un chiffre cinq fois supérieur.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Troisième producteur mondial d’énergie nucléaire – derrière les États-Unis et la France –, le Japon compte aujourd’hui une cinquantaine de réacteurs en activité générant près de 30% de l’électricité du pays. Afin de réduire sa forte dépendance à l’égard des combustibles fossiles, l’Etat nippon a opté depuis les années soixante-dix pour une stratégie privilégiant l’industrie atomique. Stimulé par de gigantesques investissements et la coopération américaine, ce secteur s’est considérablement développé autour de Toshiba, Hitachi ou Mitsubishi Heavy Industry. En 2006, le METI (Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie) a réaffirmé l’objectif de produire d’ici 2030, 50% des besoins électriques à partir de cette technologie. À telle enseigne que la construction d’une douzaine de nouvelles structures se poursuit ou a été planifiée pour les prochaines décennies.
Rappelons également que TEPCO, leader du marché japonais et quatrième firme mondiale – après RWE, EDF (Électricité de France) et E.ON – a été créée en 1951 dans le cadre de la fin du monopole énergétique de l’État. Dès les années soixante, l’entreprise connaît une forte croissance et investit dans le nucléaire : le complexe de Fukushima-Daiichi est devenu opérationnel en mars 1970. En peu de temps, TEPCO s’est imposée comme la première multinationale productrice d’électricité en Asie. Or, cette ascension fulgurante a été entachée par de nombreux scandales : en août 2002, les autorités ont révélé la falsification par l’opérateur de dizaines de documents afin de dissimuler des incidents survenus dans ses installations depuis les années soixante-dix. D’une manière générale, les polémiques impliquant l’industrie se sont multipliées avec les accidents de Tokaimura en 1999 ou de Mihama en 2004. S’agissant de TEPCO, le séisme de Chūetsu en 2007 a entraîné la fermeture de sa plus grande centrale – Kashiwazaki-Kariwa, située à 250 kilomètres au Nord de Tokyo – pendant 21 mois. La compagnie avait alors enregistré ses premières pertes en vingt-huit ans, estimées à 4,4 milliards de dollars.
Cadrage théorique
1. Réseau d’allégeances du secteur nucléaire. Dénoncées par les mouvements écologistes sous le terme d’oligarchie, les collusions qui unissent les acteurs publics et privés du nucléaire paraissent structurantes dans le déroulement de la crise. Caractérisés par leur irresponsabilité politique et judiciaire, les décideurs cherchent à maintenir une solidarité de fait, face à l’essor des critiques profanes.
2. Stratégies d’évitement (blame avoidance). Cependant, la gestion du désastre devient également le théâtre de tensions entre ces mêmes intervenants quant à l’imputation de la faute. En l’occurrence, le gouvernement, fragilisé avant même le séisme, tente d’attribuer la responsabilité de l’accident à TEPCO.
Analyse
Dans un premier temps, il convient de mettre en évidence les similarités de l’événement avec l’implication de la major pétrolière BP dans la marée noire du Golfe du Mexique en 2010. En effet, la stigmatisation d’une multinationale déviante, la mise en cause de la sous-traitance ou la chute boursière de la firme apparaissent comme autant d’éléments communs à ces conjonctures post-accidentelles. De plus, TEPCO ne semble pas en mesure de contrôler la situation car son premier plan de sortie de crise n’a été présenté que le 18 avril 2011. Quant à ses dirigeants, ils se sont simplement réfugiés dans des manifestations de contrition publique. D’autant que la communication de la compagnie s’est avérée lacunaire, voire erronée. Ces échecs répétés, qui ont achevé de ruiner la réputation de cet acteur critiqué par l’État, ont stimulé l’essor de controverses sociotechniques et d’expertises alternatives. Toutefois, à l’inverse de BP en 2010, il importe de retenir la faillite des agences nationales de régulation, en particulier la NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency), responsable des inspections au METI, et la commission NSC (Nuclear Safety Commission). Malgré l’action de lanceurs d’alarme – ou whistleblowers – comme les sismologues Katsuhiko Ishibashi et Kiyoo Mogi dénonçant en outre des conflits d’intérêt, les normes n’ont pas été révisées. Précisons que certaines recommandations de l’AIEA ont également été ignorées, parmi lesquelles le moratoire de cinq ans sur l’enrichissement et le retraitement, pourtant réclamé par l’ancien directeur Mohamed El Baradei.
Par ailleurs, notons l’attitude ambigüe du gouvernement face à TEPCO qui a été à la fois menacé de nationalisation mais simultanément soutenu par l’État. À ce titre, la mise à l’écart de l’ONG Greenpeace – pour procéder à la mesure des radiations ou à l’aménagement d’un fonds d’indemnisation destiné à éviter la banqueroute de l’entreprise – peut traduire cet appui. Rappelons que par le passé les autorités ont couvert des accidents compromettant l’opérateur, et que le scandale de 2002 n’a revêtu qu’un impact très limité sur le groupe. Soulignons ensuite les effets de l’internationalisation des acteurs du nucléaire japonais qui a accompagné la dérégulation croissante des années quatre-vingt-dix. Citons par exemple l’accord JINED (International Nuclear Energy Development of Japan Co Ltd) établi en octobre 2010 entre l’État et l’industrie pour l’export de la technologie à l’étranger. De plus, mentionnons le rôle central de TEPCO dans le cadre du Protocole de Kyoto, afin d’atteindre les objectifs du pays en matière de réduction des émissions de CO2. On voit bien là que ces proximités institutionnelles et stratégiques sont renforcées par le réseau d’allégeances unissant la haute administration et les majors de l’électricité, cristallisées dans le METI, chargé à la fois de la promotion de l’énergie atomique mais aussi des contrôles de sécurité.
Pour l’heure, cette configuration a entraîné une fermeture de l’espace des gestionnaires de la catastrophe, notamment dans la production d’évaluations des fuites radioactives. En témoigne la démission fin avril du Pr. Toshiso Kosako – conseiller scientifique du Premier ministre – en désaccord avec les mesures prises par le Cabinet. Plus encore, des commentateurs critiques ont fustigé la circulation circulaire de l’information – selon l’expression de P. Bourdieu – distillée par des responsables loyaux au secteur nucléaire. Contrairement aux États-Unis face à BP, les autorités japonaises ont donc oscillé entre une certaine solidarité envers TEPCO et une stratégie d’évitement passant par la stigmatisation d’un acteur déjà déviant. En tous les cas, la collusion et le chevauchement – ou straddling – entre public et privé, ne sont pas remis en cause en tant que tels. Apparaît alors le risque de free-riding – ou cavalier seul – d’un État participant au contrôle, voire à la dissimulation d’informations au nom de ses priorités stratégiques. Cette organisation du secret – qui ne saurait être imputée à une prétendue spécificité japonaise – représente un danger non seulement pour la population, mais dans ce cas précis, également pour les biens publics mondiaux. Or, ceci s’avère d’autant plus problématique que les instances internationales de régulation – dont l’AIEA – se préoccupent davantage du versant militaire d’une technologie à l’usage civil toutefois particulièrement risqué.
Références
Chateauraynaud Francis, Torny Didier, Les Sombres précurseurs : une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, Éds. de l’EHESS, 1999.
Ishibashi Katsuhiko, « Why Worry? Japan’s Nuclear Plants at Grave Risk from Quake Damage”, International Herald Tribune, 11 août 2007.
McCormack Gavan, « Le Japon nucléaire ou l’hubris puni », Le Monde diplomatique, avril 2011.
Poirmeur Yves, « Qu’est-ce qu’une information loyale ? », in: Josepha Laroche (Éd.), La Loyauté dans les relations internationales, 2e éd., Paris, L’Harmattan, 2011. Coll. Chaos International.
Weaver Kent R., « The Politics of Blame Avoidance », Journal of Public Policy, 6 (4), 1986, pp. 371-398.